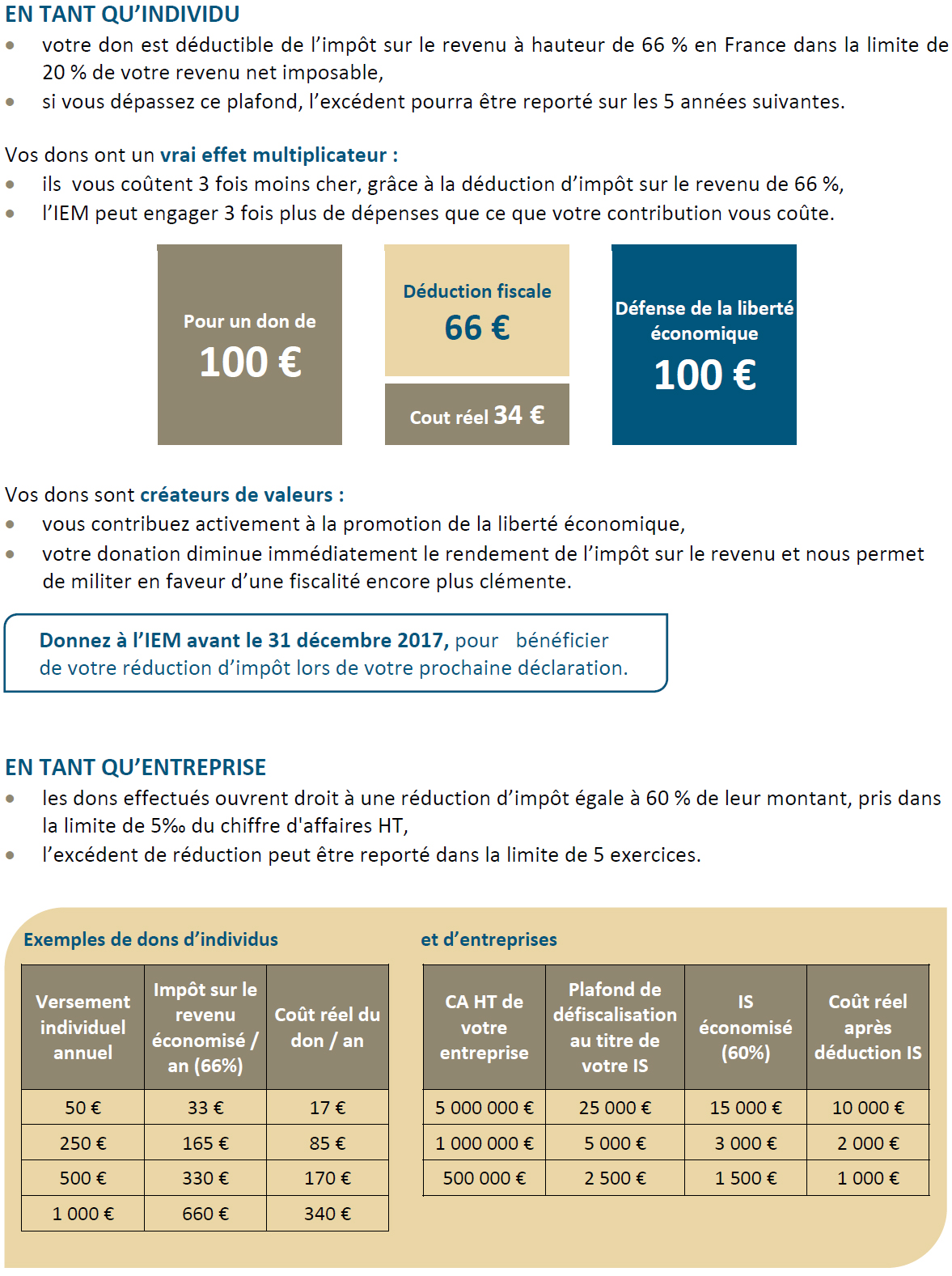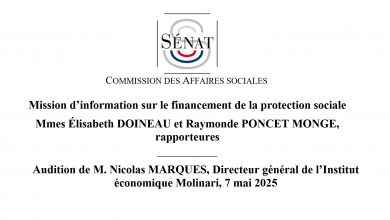Retraite, les limites de la loi de 2010
Article publié exclusivement sur le site de l’Institut économique Molinari.
Ça y est, le mauvais feuilleton de la réforme des retraites a pris fin. La réforme est promulguée et validée par le conseil constitutionnel. Les grèves sont finies, il n’y a plus de stations services en rupture de stock d’essence, de lycées bloqués. Les surenchères politiciennes ont pris fin et plus aucun étudiant ne revendique la prise en compte des années d’études dans le calcul des annuités de cotisation. Le président de la République, fidèle à lui même, vient même d’enfourcher un nouveau cheval de bataille, celui de la dépendance. Il veut créer une « nouvelle branche de la Sécurité sociale, le cinquième risque ». Un projet plus qu’ambitieux dans le contexte actuel. Alors, faut-il se réjouir de la réforme des retraites? Pas si sûr car, une fois de plus, la démarche a été émaillée d’erreurs.
La première erreur consiste à continuer à faire du micro-management, au lieu de faire les réformes de fond. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics enchainent les réformes paramétriques, à faible portée, à l’image de ce qui a été fait en 2003, 2007-2008 ou en 2010. Ils interviennent concrètement dans la gestion des retraites, en durcissant progressivement les conditions de départ à la retraite, sans jamais mettre les gestionnaires de l’Assurance vieillesse devant leurs responsabilités. Toutes ces lois, destinées à améliorer à moyen terme l’équilibre financier de la répartition, ont en effet éludé le cœur du problème. Si les déficits réapparaissent d’année en année, voire se creusent, c’est avant tout parce que l’Assurance vieillesse ne dispose d’aucun mécanisme de gouvernance digne de nom. Gérée comme le Trésor Royal sous l’ancien régime, elle est incapable de réconcilier ses recettes et ses dépenses. Aucune règle interne ne garantit que les promesses faites aux futurs retraités soient en rapport avec les recettes attendues. Contrairement à ce qui se fait chez nos voisins ou dans nos régimes complémentaires, pas de points, pas de comptes notionnels. La caisse nationale, totalement déresponsabilisée, applique la loi et attend patiemment que les parlementaires la change, pour corriger les dérapages financiers les plus criants. Dans ces conditions il n’est pas étonnant que le premier régime de base retraite français soit moins bien géré que celui de ses homologues étrangers ou que les caisses complémentaires.
La deuxième erreur est de continuer à politiser le processus. Au lieu de laisser les gestionnaires des caisses décider, en s’appuyant sur des conseils d’administration paritaires ayant des pouvoirs réels – à l’instar de ce qui se fait pour dans les régimes complémentaires – le gouvernement s’expose. Dans un contexte de vieillissement mettant particulièrement à mal les régimes par répartition, il est conduit à proposer des décisions difficiles qui l’exposent aux critiques de son opposition ou des partenaires sociaux. Il a donc tendance à repousser les ajustements à plus tard ou à rechercher un consensus minimal sur les réformes qu’il propose de voter, quitte à les accompagner de mesures compensatoires coûteuses. La pratique montre que les dernières réformes, notamment celles de 2003, ont été acquises moyennant la mise en place de compensations neutralisant tout ou partie des effets positifs de la réforme en jeu. La reconnaissance des carrières longues a par exemple obéré une partie de l’intérêt économique à court voire à moyen terme de la réforme de 2003. La loi de 2010, en consacrant la pénibilité, pourrait tomber dans ce travers.
La troisième erreur consiste à continuer à recourir aux expédients financiers. Pour limiter l’ampleur des déficits attendus, le gouvernement a une fois de plus multiplié les taxes : hausse des prélèvements sur les stock-options, création d’un prélèvement de 1% sur la dernière tranche de l’impôt sur le revenu, énième prolongation de la durée de vie de la caisse d’amortissement de la dette sociale, détournement des recettes du fonds de réserve des retraites. Ces mesures, qui simplifient l’équation financière à court terme, ne permettront jamais de faire face aux besoins de financement attendus. Pire, elles nous éloignent de la philosophie de la répartition, selon laquelle les pensions versées aux retraités devraient être financées par les cotisations prélevées par les actifs.
Enfin, les débats autour de la réforme ont particulièrement péché sur le plan pédagogique, en occultant les limites du mode de financement actuel des retraites. Là où la loi Fillon de 2003 avait consacré l’intérêt d’une épargne retraite complémentaire, en créant le PERP et le PERCO, la loi de 2010 a ignoré la nécessaire montée en puissance de la capitalisation. Si quelques amendements ont permis d’améliorer les dispositifs d’épargne existants, aucune pédagogie de grande envergure n’a été faite. Personne n’a osé rappeler aux français que la préservation de leur pouvoir d’achat à la retraite passerait nécessairement par plus d’épargne. Pire la loi sur les retraites, comme le projet de loi de sécurité sociale, cultivent une opposition stérile entre capitalisation et répartition. Ils intègrent une série de dispositions fiscales anti-épargne : hausse des prélèvements sur les plus-values de cessions mobilières et immobilières, hausse du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et intérêts, hausse du forfait social. Autant de mesures qui pénaliseront les épargnants, en limitant d’autant leur capacité à se constituer un complément de retraite.
Espérons que la prochaine réforme des retraites, annoncée pour 2018, sera d’une meilleure facture…
Nicolas Marques est chercheur associé à l’Institut économique Molinari.