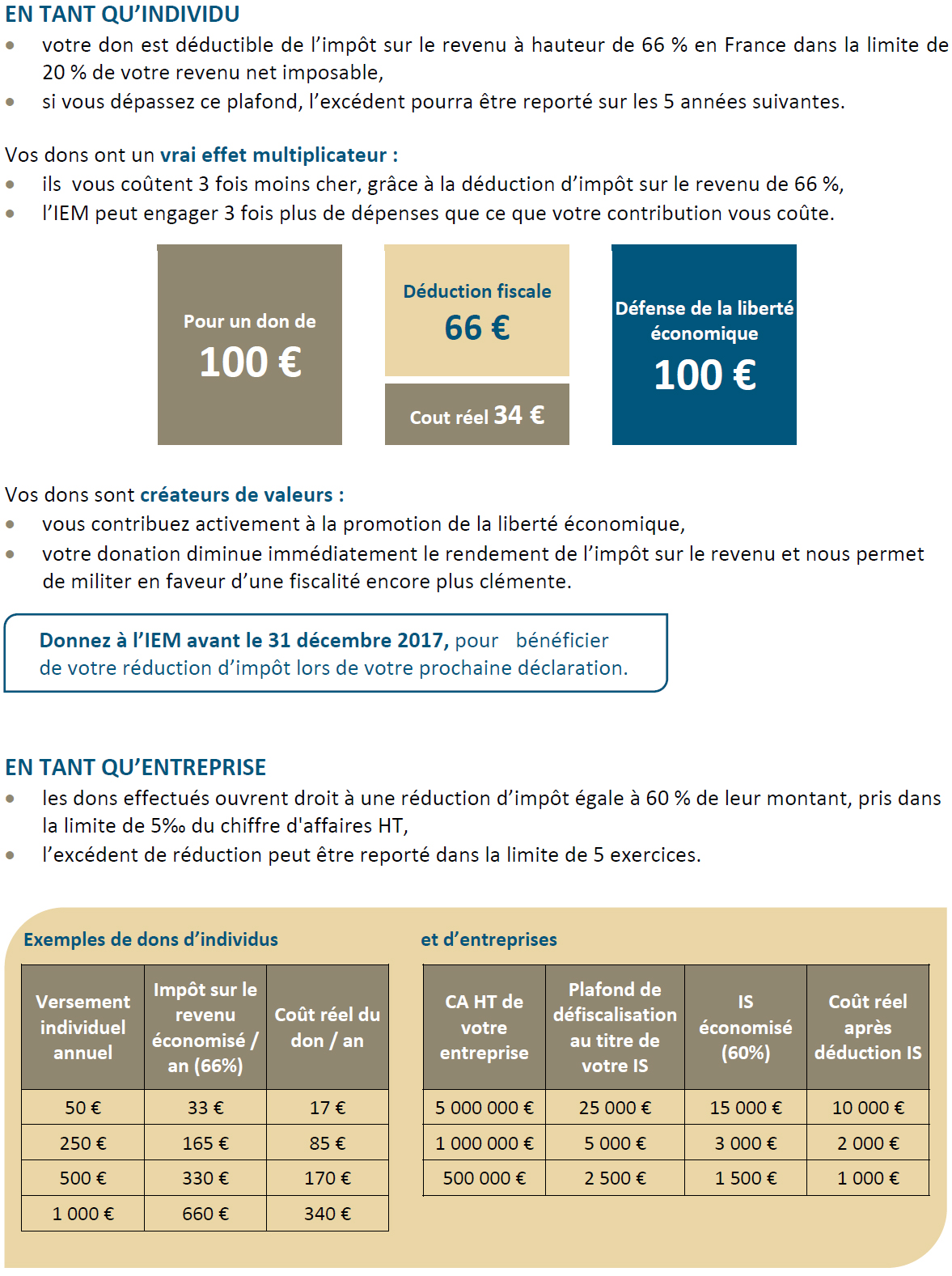Le capital et les boomers ne se gavent pas
L’intervention du Premier ministre sur TF1 a braqué les projecteurs sur les pensions des baby-boomers, accusés de vivre « de rentes ». Interview avec Nicolas Marques, directeur général de l’Institut économique Molinari, publiée le 29 août 2025 sur Atlantico.
Faut-il penser que le capital se « gave » sur le travail, comme on l’entend souvent dire ?
Nicolas Marques : Non. En France, le capital ne se gave pas sur le travail. Les chiffres montrent que le partage de la valeur est favorable aux salariés, qui reçoivent 80 % de la valeur ajoutée lorsqu’on intègre les cotisations sociales. Le capital reçoit seulement 17 % de la valeur ajoutée nette, un chiffre moins élevé qu’ailleurs en raison de l’importance des prélèvements obligatoires. Les entreprises subissent notamment une anomalie française : les impôts de production, qui captent 3 % de la valeur ajoutée.
Tous ceux qui disent que le capital se gave depuis des décennies ne regardent pas les données ou le font avec des œillères. Leur vision est d’autant plus problématique qu’elle inverse les causalités.
Le problème en France est que nous n’avons pas assez de capital pour financer un niveau de croissance significatif. C’est d’ailleurs également vrai en Europe. Pourquoi ? Parce qu’il faut du capital pour accompagner le développement des entreprises. Elles ont besoin d’argent pour innover et se développer. Les entreprises ne peuvent pas se financer exclusivement par de l’emprunt ou par de l’autofinancement sur leurs bénéfices, surtout dans les domaines nouveaux comme la tech ou la biotech, où les résultats sont très incertains. Comme nos marchés de capitaux ne sont pas assez développés, nous avons moins d’investissements et moins de création de richesse dans ces secteurs innovants. En Europe, globalement, il nous manque plus de dix-neuf mille milliards de capitalisation boursière actions pour financer le développement de nos entreprises. La capitalisation des entreprises de l’Union européenne représentait 65 % du PIB dans l’Union européenne contre 177 % du PIB aux États-Unis fin 2023. L’écart, 112 % du PIB, correspond au retard de capitalisation boursière européen de 19 300 milliards d’euros.
Dans un monde où les capitaux propres servent à financer les innovations de rupture telles que l’intelligence artificielle, ce manque de capitalisation boursière des entreprises européennes rime avec retard dans la course à l’innovation et déclassement. C’est ce qui explique que la croissance économique en Europe est moins élevée que dans d’autres zones, comme les États-Unis ou la Chine, et que nous sommes à la traîne dans l’innovation.
Cibler le capital, c’est aussi commettre une double erreur, vis-à-vis des salariés et des services publics. Moins de capital, c’est moins de création de richesse, donc un marché du travail moins dynamique, avec plus de chômage et des salaires moins attractifs. C’est aussi plus de difficultés à financer les services publics par l’intermédiaire des prélèvements obligatoires. Les entreprises collectent des cotisations patronales, des cotisations salariales, paient l’impôt sur les sociétés et, en France, des impôts de production, une taxe anti-économique puisqu’elle cible l’outil de production indépendamment des profits qu’il génère. Lorsque le capital manque, les entreprises sont moins dynamiques et redistribuent moins aux salariés et aux administrations.
Ceux qui sont persuadés qu’il suffirait d’augmenter la taxation sur le capital pour améliorer la santé de nos finances publiques se trompent. Cela peut augmenter les recettes à très court terme, mais dès que le capital se met en mobilité, il s’investit ailleurs et fructifie ailleurs. Finalement, ce sont des mesures qui appauvrissent à long terme.
Dans un pays où tant bénéficient de facto d’une rente, quelle peut être selon vous la solution ? Peut-on seulement réformer le pays ?
Nicolas Marques : Je ne pense pas que le terme de rente permette de mieux comprendre les enjeux. Il y a des rentes légitimes et d’autres illégitimes, et surtout des rentes créatrices de richesse et d’autres destructrices de valeur. Un exemple : les retraites sont assimilables, par différents aspects, à une rente. Mais il y a de bonnes et de mauvaises rentes. Les pensions des fonctionnaires coûtent aux contribuables plus de 60 milliards d’euros par an, car l’État n’a rien mis de côté et lève des impôts ou de la dette pour les financer. En revanche, les retraites des employés de la Banque de France ne nous coûtent rien. Elles sont auto-financées par une capitalisation collective, grâce aux dividendes et plus-values générés par les capitaux placés par la banque centrale au sein de son fonds de pension. Les retraités de la Banque de France bénéficient d’une rente vertueuse qui crée de la richesse collective. Lorsque les syndicats de la Banque de France ont défilé en 2020 pour défendre leur régime particulier, ils défendaient l’intérêt général. Le vrai sujet est que l’épargne retraite est insuffisante, ce qui nous rend trop dépendants de la fiscalité.
Jusqu’à présent, nous finançons nos services publics – et notamment nos retraites – quasi exclusivement par les prélèvements obligatoires, ce qui fait que le rapport qualité-prix des prestations sociales françaises n’est pas bon. Notre dernière étude montre qu’un salarié moyen paie 54 % de charges et d’impôts, lorsqu’on tient compte des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et de la TVA. Les retraites représentent le premier poste de dépense avec 12 100 € de cotisations sociales par an pour un salarié moyen. Financées quasi exclusivement en répartition, elles ont un rendement moindre que dans les pays ayant développé des capitalisations collectives. Les retraites coûtent 30 % plus cher aux salariés français, avec des cotisations prélevées sur les salariés représentant 28 % du salaire brut, contre 21 % en moyenne dans l’UE, pour un taux de remplacement à la retraite représentant 72 % du salaire contre 68 % dans l’UE.
En laissant croire que les retraités sont des nantis et en éludant ce problème de fond, le Premier ministre commet une double erreur.
D’une part, c’est illégitime de laisser croire que les retraités bénéficieraient d’avantages exorbitants. En 2023, les retraités avaient un niveau de vie comparable à celui des Français. Le retraité moyen disposait de 29 400 euros par an, soit légèrement moins que le Français moyen (29 600 euros). Si les boomers sont des « nantis », la moitié des Français le sont aussi. Le niveau de vie du retraité est en moyenne inférieur de 11 % à celui de l’actif moyen et équivalent à celui du trentenaire moyen. Pensez-vous que les trentenaires sont des nantis ? Cette approche est ridicule et dangereuse, car elle oppose de façon non constructive les classes d’âge.
Ajoutons que la retraite par répartition des boomers équivaut à un placement qui rapporterait seulement 2 % par an, soit un retour sur cotisation médiocre. Si nos retraités avaient capitalisé davantage, ils seraient de vrais rentiers, avec des retraites plus généreuses dont le financement reposerait moins sur les actifs et les finances publiques.
Dans quelle mesure faut-il, si l’on poursuit la réflexion du Premier ministre, déplacer le problème et envisager une solution passant par la réforme de notre système de retraite et l’introduction d’un pilier de capitalisation ?
Nicolas Marques : Il faut traiter le problème de fond. En France, la capitalisation retraite est insuffisamment développée, d’où notre pression fiscale record. Elle représentait 13 % du PIB fin 2024, contre 92 % dans les pays de l’OCDE, soit un écart de 1 à 7. D’un point de vue individuel, ce sous-développement de l’épargne retraite représente une « taxe implicite » de 1 700 euros par an et par actif ou retraité, par rapport à la moyenne de l’OCDE. D’un point de vue macroéconomique, le manque à gagner est de l’ordre de 3 points de PIB ou d’une centaine de milliards d’euros chaque année. Tant que cette anomalie ne sera pas corrigée, les déficits s’accumuleront et la situation des actifs comme des retraités se dégradera. Et si rien n’est fait, le pouvoir d’achat des retraités devrait chuter de 13 % par rapport au reste de la population d’ici 2070, la répartition ne permettant pas de financer des retraites généreuses lorsque la démographie n’est plus au rendez-vous.
Nous subissons une crise systémique liée au vieillissement. La France dispose d’un modèle social développé, avec un État et des administrations publiques significatifs, mais ce modèle n’a pas été adapté aux tendances de fond que représentent la baisse de la natalité et le vieillissement. Ce n’est pas un hasard si le dernier équilibre des finances publiques remonte à 1974, qui correspond à la fin du baby-boom, et si nos comptes se dégradent sans cesse depuis. C’est une conséquence du vieillissement. Le nombre de retraités qui ne contribuent globalement pas à la création de richesse a augmenté de manière significative, tandis que le nombre d’actifs est resté stable. C’était évidemment prévisible, car cela correspond aux tendances démographiques de fond. La France a été un des premiers pays européens à réaliser sa transition démographique ; elle vieillit depuis la fin de l’Ancien Régime. On l’a oublié avec la parenthèse du baby-boom, mais nous en revenons maintenant aux tendances de fond. De plus en plus de personnes âgées dépendent de la collectivité, tandis que le nombre d’actifs stagne, ce qui exerce une pression sur les actifs et sur les finances publiques.
Le vrai courage politique serait d’assumer cette réalité et de généraliser la capitalisation collective. La capitalisation est obligatoire dans la fonction publique depuis 20 ans, suite à la création de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). Elle est aussi obligatoire dans certaines professions (la caisse de retraite des pharmaciens, la CAVP, fonctionne à la fois en répartition et en capitalisation). Elle est également la règle chez certains employeurs vertueux, sous une forme obligatoire (Banque de France, Sénat…) ou facultative (plans d’épargne retraite collectifs ou obligatoires…). Il faudrait la généraliser dans le secteur privé, en s’appuyant sur les caisses complémentaires (Agirc-Arrco). En parallèle, il faudrait provisionner les retraites de l’État, en dupliquant le modèle vertueux de la Banque de France.
L’enjeu n’est pas de présenter les retraités comme des nantis – pour légitimer des hausses d’impôts – mais de faire en sorte qu’il y ait plus de moyens pour financer les services collectifs, tout en réduisant la fiscalité.