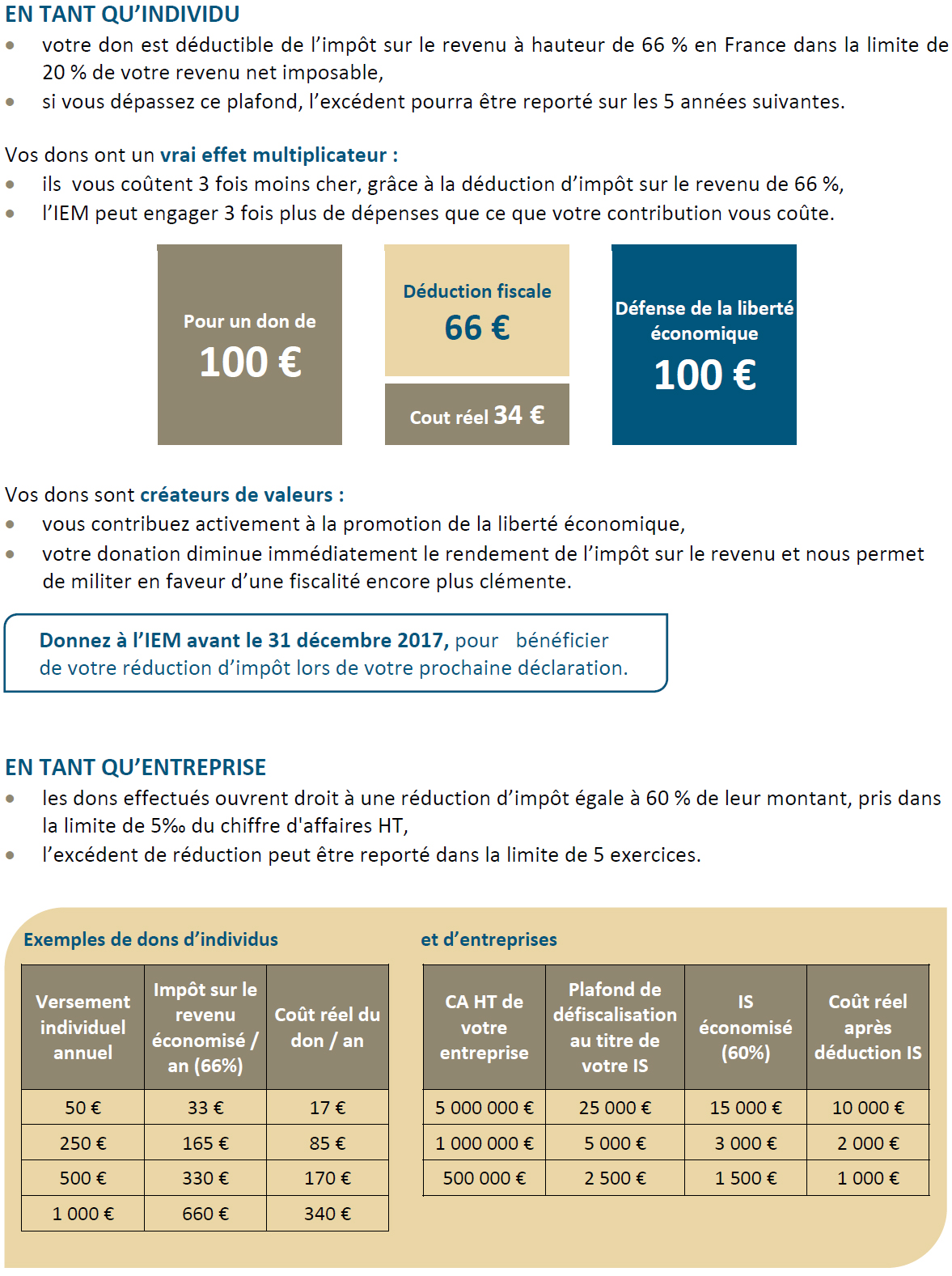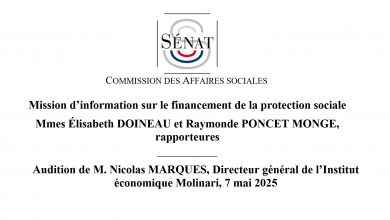Le mythe du sous financement de la protection sociale
Pour sauver le modèle social français, il faudra apprendre à faire mieux sans augmenter les cotisations. Texte d’opinion par Nicolas Marques, économiste et directeur général de l’Institut Molinari, publié dans L’Express.
Le débat autour de la loi sur le pouvoir d’achat a donné lieu à des prises de position critiquant certaines mesures, présentées comme mettant à mal le financement de la protection sociale. Certains pensent même que les défenseurs de ce texte creusent volontairement le déficit de la sécurité sociale en pratiquant la « politique des caisses vides ».
De quels montant parle-t-on ? La prime Macron représentait 2 milliards d’euros en 2021, une goutte d’eau par rapport aux 562 milliards de salaires bruts versés par les entreprises. La nouvelle prime, configurée pour protéger le pouvoir d’achat, pourrait représenter 6 milliards d’euros en 2022, soit de l’ordre de 1 % des salaires bruts du privé. Comment penser qu’elle pourrait déstabiliser les comptes de la sécurité sociale ?
De même, l’impact de la réduction des cotisations sociales sur les heures supplémentaires et les RTT non prises sera marginal. Les heures supplémentaires ont déjà bénéficié d’un tel aménagement dans le cadre de la loi TEPA de 2007 à 2012 et le « manque-à-gagner » pour comptes sociaux représentait à peine 1 % des recettes. Quant à la possibilité de monétiser des jours de repos non pris, elle n’est pas entièrement nouvelle. Jusqu’à présent, elle était conditionnée au versement dans un dispositif d’épargne retraite collectif et représentait des flux minimes.
Selon leurs contempteurs, ces dispositifs se surajouteront à d’autres, déséquilibrant eux-aussi les comptes sociaux, de l’épargne salariale à la protection sociale complémentaire. Là encore, le propos doit être tempéré.
Les montants distribués au titre de l’épargne salariale restent modestes eu égard aux rémunérations. L’intéressement, la participation et l’abondement représentaient 4 % de la masse salariale en 2020. Surtout, contrairement à l’image d’Epinal, il ne s’agit pas de « niches » exemptes de prélèvements. Ils sont soumis au forfait social, pouvant représenter jusqu’à 20 % des sommes versées par l’entreprise, sans que cela génère de bénéfice pour le salarié. Si du point de vue comptable, le « manque-à-gagner » pour la sécurité sociale représenterait 1,7 milliards par an, c’est en faisant l’hypothèse que l’épargne salariale se développerait de la même façon si elle était assujettie aux cotisations salariales traditionnelles, ce qui est peu probable.
Notons aussi que l’épargne salariale « coûte » moins que les compléments de rémunération dans le public. Les primes et indemnités, qui constituent 25 % des rémunérations d’activité versées par l’Etat, sont exonérées de cotisation sociales classiques, contrairement aux bonus versés par les employeurs privés. Rien que pour les fonctionnaires d’Etat, cela représente un manque-à- gagner de 1,9 milliard par an pour l’assurance maladie.
De même, la prévoyance complémentaire santé n’est pas une « niche ». Elle participe de l’effort de protection sociale et, à ce titre, les cotisations des entreprises devraient être exonérées de charges. Elles sont pourtant soumises au forfait social au taux de 8 %, alors que les pouvoir publics ont rendu ces dispositifs obligatoires. Elles bénéficient donc d’un traitement moins favorable que les cotisations finançant le régime général d’assurance maladie.
Certains considèrent que les ressources de la sécurité sociale seraient encore plus élevées si ces aménagements n’existaient pas. Mais ce raisonnement, purement comptable, conduit à calculer des « pertes » par rapport à une situation hypothétique où le taux de cotisation standard serait la norme. Or, derrière la grande majorité des aménagements se cache une bonne explication, qu’il s’agisse de financer la protection sociale complémentaire ou d’améliorer l’employabilité des personnes à bas salaires. Si l’on souhaitait revenir sur ces aménagements, il faudrait en contrepartie accepter une baisse des taux de cotisation standard pour préserver la compétitivité et le pouvoir d’achat. Dans le cas contraire, il est fort probable que les moyens à disposition pour financer la protection sociale diminueraient.
D’une manière générale, l’idée d’un « définancement » n’est pas corroboré par les faits. C’est l’inverse qu’on constate en France. Les ressources de la protection sociale sont passées de 16 % du PIB en 1959 à 36 % en 2020. Loin de stagner, elles sont plus élevées que partout ailleurs en Europe. L’écart est par exemple de 7 points vis-à-vis de la Suède, pays avec des prestations très qualitatives et une espérance de vie en bonne santé meilleure que chez nous (73 ans vs 65 ans). En matière de protection sociale, l’enjeu est d’apprendre à faire mieux sans augmenter les cotisations, sauf à penser que la compétitivité et le pouvoir d’achat sont accessoires.