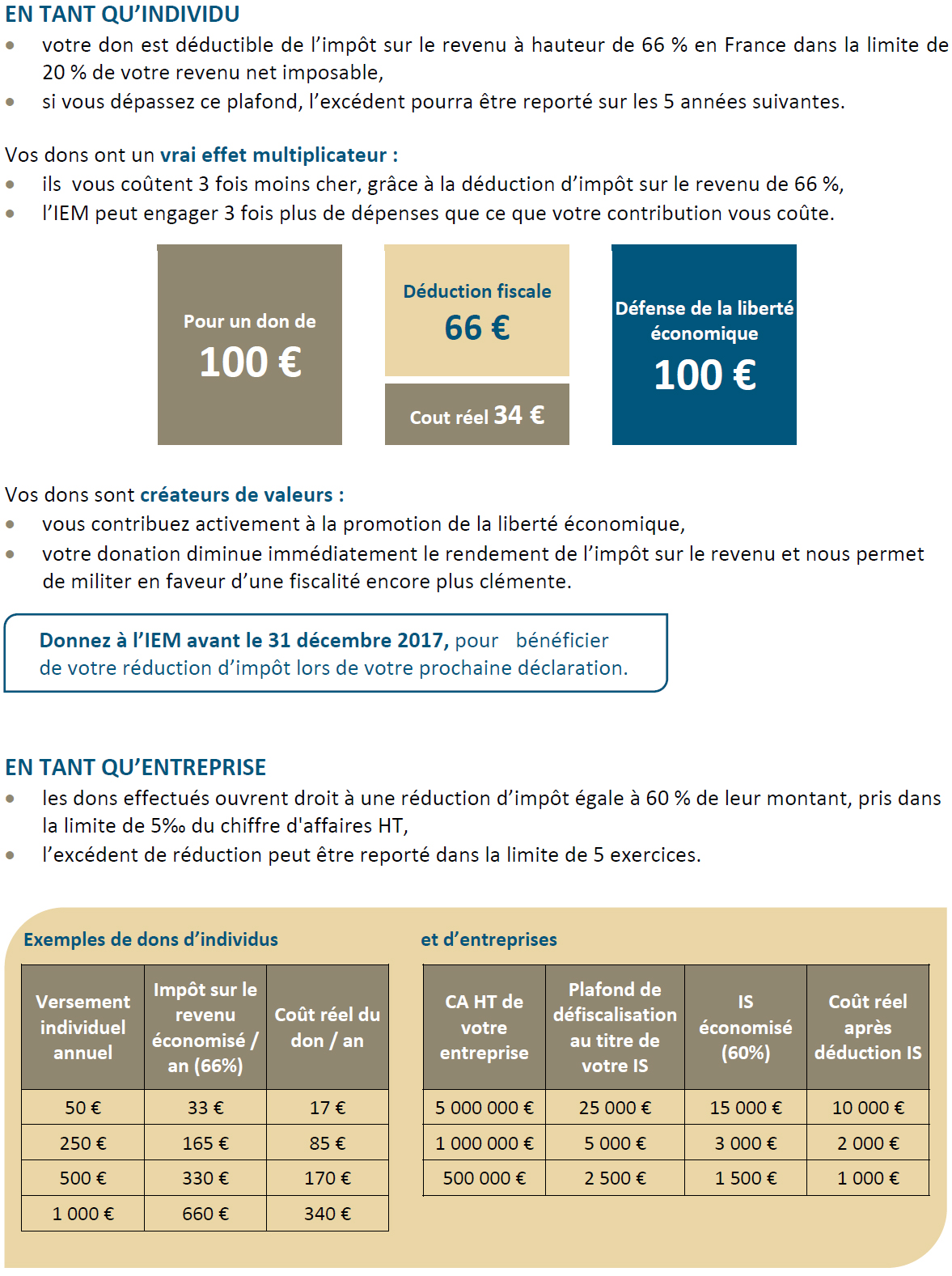12 mois avec un gouvernement démissionnaire – In vivo
Article de Philippe Plassart publié dans Le nouvel Économiste le 9 juin 2011.
La Belgique fait-elle la démonstration de la viabilité d’un exécutif aux prérogatives réduites ?
Un cas de figure inédit ! Cela fait un an que la Belgique a à sa tête un gouvernement vraiment pas comme les autres. Sa particularité ? Démissionnaire depuis le 26 avril
2010, il gère les “affaires courantes” du pays, une situation singulière née du refus des partis de former une coalition gouvernementale avant d’avoir levé le préalable d’une réforme de l’État. Mais cette réforme de l’État – dont le point essentiel porte sur la régionalisation de la sécurité sociale –, revendication du parti nationaliste flamand vainqueur des élections – n’avance guère. Si bien que la solution, au départ provisoire, du gouvernement démissionnaire en charge des affaires courantes semble s’être installée durablement, certains observateurs pariant même désormais sur la perpétuation de cette expérience jusqu’au terme de la législature et des nouvelles élections. Or surprise, de l’avis quasi général des observateurs de la scène belge, la Belgique ne semble pas se porter plus mal pour autant. Nos voisins ne seraient-ils ainsi en passe de faire la démonstration de la viabilité d’un exécutif aux prérogatives réduites – mieux, son efficacité ! – apportant de l’eau au vieux rêve libéral de “l’État minimum” ?
Une forme d’ultra-pragmatisme
Face à la volonté commune de donner la priorité à la réforme de l’État sur la formation d’une nouvelle coalition, le pays aurait pu se bloquer totalement. Ou sombrer dans l’anarchie. Rien de tel. Si l’impact de cette crise apparaît de prime abord limité, cela tient en grande partie à la structure des pouvoirs du pays. En réalité, un seul élément du dispositif qui n’est certes pas le plus négligeable -le gouvernement fédéral – est touché, les six autres gouvernements – trois régionaux, trois communautés – continuant leur travail comme si de rien n’était. Or ces derniers ont en charge une partie importante des interventions économiques, l’enseignement, la culture, autant de domaines non affectés par la crise. La surprise vient de la résilience du fonctionnement de l’échelon fédéral. Les ministres, les secrétaires d’État occupent leur poste et les services fonctionnent, la meilleure preuve de cette continuité ayant été la manière sans anicroche dont la Belgique a contribué à la présidence de l’Union européenne l’an dernier, analyse Vincent Decoorebyter, directeur général du Crisp, centre de recherche et d’information en sciences politiques. Mais la longueur de la crise a placé le pays devant la nécessité d’élargir ce concept d’affaires courantes. “L’extension du domaine s’est opérée au nom de l’urgence, des obligations internationales et du consensus “à la belge””, reprend le politologue. Ainsi le gouvernement est-il en passe d’adopter une loi de finances en bonne et due forme à la fin du mois de mai ; après avoir engagé les troupes belges en Libye et être intervenu pour finaliser un accord interprofessionnel laissé inachevé par les partenaires sociaux du fait de l’opposition d’un des syndicats. “Les Belges font preuve d’ingéniosité en profitant du flou juridique entourant la notion d’affaires courantes. Et ils s’appuient sur l’architecture institutionnelle du roi qui a donné à plusieurs occasions sa caution à cette démarche. Le tout reposant sur la valeur accordée au consensus.”
L’État minimum est encore loin
Du point de vue des canons de la pensée libérale, ce gouvernement n’est en rien un gouvernement réduit. “Dans le régime des affaires courantes, le niveau des dépenses et des impôts reste le même qu’avec un gouvernement de plein exercice. Il y a toujours autant de fonctionnaires”, observe Drieu Godefridi, président de l’institut Hayek, et entrepreneur. Et en limitant momentanément son pouvoir d’initiative, la classe politique est loin de se faire hara-kiri. “Les circonstances sont exceptionnelles. Elles tiennent à la volonté de tous les partis de subordonner la remise en route gouvernementale à la réforme étatique. Et le parti flamand (censé être au pouvoir à la tête d’une coalition) reste à la manoeuvre. Nul coup de force dans ce gouvernement d’affaires courantes. Le seul rouage constitutionnel qui fait défaut étant la mise en responsabilité de l’exécutif devant le Parlement”, reprend l’idéologue libéral. Seul bénéfice à ses yeux de l’expérience : elle démontre qu’un gouvernement peut faire un excellent travail en se privant des effets d’annonce. Une analyse qui fait écho à celle de Vincent Decoorebyter : “Le régime actuel est toléré dans la mesure où le gouvernement avance prudemment et qu’il ne rencontre pas d’opposition.” Question cette tempérance qui est à mettre à l’actif de l’expérience résistera- t-elle à l’épreuve du temps ?
Le risque de la banalisation et de la dépolitisation
A défaut de réinventer un État minimum tout entier concentré à assurer les fonctions régaliennes de la puissance publique – justice, sécurité, défense –, les Belges ont-ils gagné des marges de liberté et d’autonomie ? Pour Cécile Philippe, directrice de l’institut Molinari, basé à Bruxelles, une régionalisation plus poussée ouvrirait de nouveaux espaces à la concurrence et donc des gains pour la citoyenneté économique, foi de libéral. Mais à court terme, ce gouvernement laisse la majorité des Belges indifférents après une poussée de mobilisation citoyenne à la fin de 2010. Et personne ne croit aux vertus de la banalisation de la crise. “Cela signifierait qu’un gouvernement qui n’est plus contrôle par le Parlement peut étendre son domaine d’action, une tendance qui mettrait en cause le principe d’équilibre des pouvoirs”, s’alarme Vincent Decoorebyter. Or chez beaucoup de Belges, dépassés par la complexité institutionnelle actuelle, l’idée s’installe qu’un pays n’a pas besoin d’un gouvernement et que l’on peut se passer des politiciens. Une conclusion qui ne peut être que confortée par la durée de la crise actuelle.