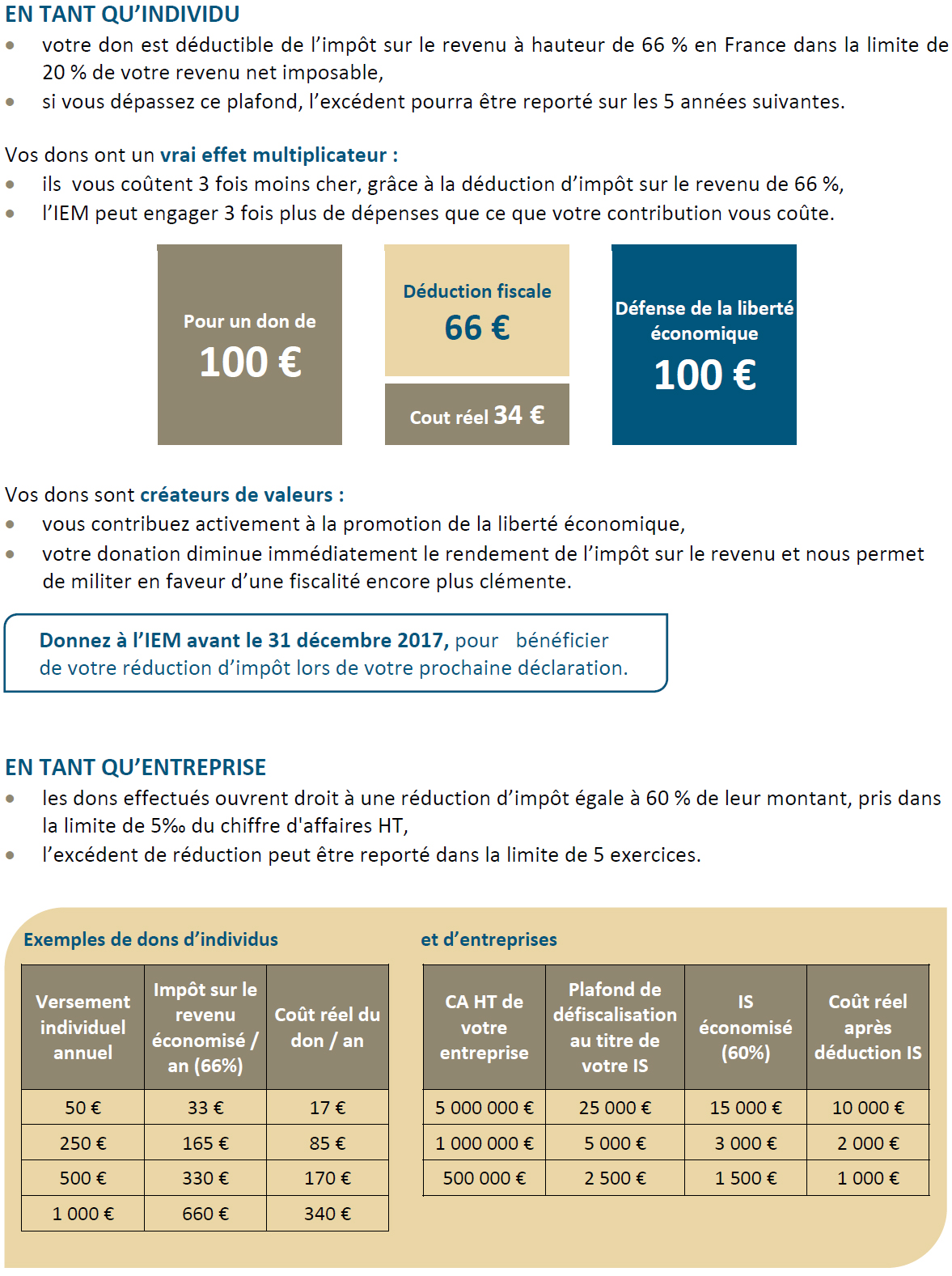La fiscalité contre l’Économie? Une leçon de Pierre le Pesant de Boisguilbert
Texte d’opinion par Michel Monier, membre du Cercle de recherche et d’analyse de la protection sociale (think-tank CRAPS) et ancien DGA de l’Unédic, publié en exclusivité sur le site de l’Institut économique Molinari.
« Il n’y a plus assez d’huile dans la lampe » : c’était l’alerte de Pierre le Pesant de Boisguilbert aux Contrôleurs généraux du royaume avec son « Détail de la France, la cause de la diminution de ses biens[1] ». Nous sommes alors en 1695. Il ne sera pas entendu. Les « Boisguilbert » qui sont succédés ne l’ont pas été davantage. En 2025, comme en 1695 : il n’y a plus assez d’huile dans la lampe : la France voit diminuer ses biens.
Dans quels détails se cachent aujourd’hui les raisons de cet irréductible manque d’huile ? Un regard sur une trentaine d’années (1990-2022), nous fait voir que, si l’on produit toujours plus d’huile, la machine France, mal réglée, a un mauvais rendement. La production ne suffit pas à nos dépenses. Un regard porté au-delà de l’hexagone aggrave le constat : nous vivons à crédit et perdons des places au classement mondial, notre niveau de vie relatif se dégrade. Inspiré par Boisguilbert, regardons quelques-uns de ces détails de la France[2], possibles explications de l’insuffisance d’huile dans la lampe.
« Revue des détails » : tenter de comprendre pour agir.
Détail 1. La population augmente de 17% entre 1990 (58 millions) et 2022 (68 millions). Dans le même temps, la production nationale – ce PIB qui ne nous dit pas tout, mais nous dit beaucoup – a augmenté de 149% (de 1037 à 2588 Mds à prix courants).
Détail 2. Nous sommes encore (?), avec notre PIB, au 7ème rang mondial. Dans le détail du PIB, le PIB par habitant[3] (39323 €/ habitant), cet indicateur qui donne une idée du niveau de vie, nous classe au 25ème rang mondial ! C’est moins bien, et c’est d’autant moins bien que nous étions au 11ème rang en 1990. Cette dégradation relative du PIB/habitant intervient alors que cet indicateur du niveau de vie a gagné 114% (18297 € en 1990, 39323 € en 2022).
Détail 3. Les 2588 Mds €, c’est le résultat d’une production de richesse de 87402 € par emploi. L’écart entre ce PIB/emploi et le PIB/habitant s’explique, principalement, par le niveau de la population en âge de travailler, par le taux de chômage et l’intensité capitalistique de l’outil de production. Sur la période, le PIB par tête augmente davantage que le PIB/emploi. L’écart entre les deux se réduit, mais se réduit peu : en 1990, le PIB/habitant (18297 €) représentait 41% du PIB/emploi en 1990, avec 39323 € en 2022 il représente 45% du PIB/emploi.
Détail 4. L’emploi marchand comptait 15,8 millions de « producteurs » en 1990 ; il en compte 21 millions en 2022, soit + 32%. Le taux d’emploi marchand/population augmente de 27,2 à 30,8% sur la période. L’emploi public, dont on considèrera ici qu’il ne participe pas à la création directe de richesses mais consomme des prélèvements sur le PIB pour fabriquer des prestations et services publics, a lui évolué de 4,65 à 5,7 millions (soit +22%, 5 points de plus que la population) pour représenter aujourd’hui un taux d’emploi, rapporté à la population, de 8,3% (8% en 1990) et 21% de l’emploi total.
Détail 5. Le faible taux d’emploi est-il compensé par la productivité des « actifs-actifs » ? Á regarder la déclinaison du PIB/emploi au niveau du PIB par heure travaillée, nous sommes au 13ème rang des pays de l’OCDE. Ce rang nous positionne à un niveau significativement supérieur (+17 points, soit +23%) à la moyenne OCDE. Á ce niveau de détail, nous ne tenons pas notre rang de 7ème puissance économique. Y a-t-il des « fuites » dans la machine et produit-elle assez ?
Détail 6. La France a fait le choix d’une économie post-industrielle : une économie « sans usine », une économie de la connaissance et des services. La contribution au PIB (2022) des divers secteurs économiques l’illustre. Le secteur principal contributeur est celui des services avec 80%, l’industrie contribue pour 18% (l’agriculture à un niveau très résiduel, apporte 2%).
Détail 7. L’appareil d’État prélève l’équivalent de 45% de PIB (2022) pour contribuer à hauteur 12 à18% à la création de richesses[4]. En termes de PIB (qui ne prend pas en compte les biens gratuits que sont les prestations et services publics), l’appareil d’État transforme des « intrants », à hauteur de 45% de PIB, en une contribution au PIB de 12 à18%. L’écart entre les 45 et les 12 à18% n’est pas perdu. L’écart entre prélèvements obligatoires et contribution de l’Administration au PIB se retrouve sous la forme de la redistribution monétaire. L’INSEE[5] l’estime à 25% du PIB : ¼ de PIB est transformé en argent magique. Il reste à expliquer où passe « la part de l’ange », celle qui est financée par la dette et qui porte la dépense publique de 45 à plus de 50% de PIB.
Détail 8. Le taux de prélèvements obligatoires (PO) est passé de 41% (en 1990) à 45,3% (2022). L’augmentation se présente raisonnable mais s’applique à un PIB en augmentation. La recette publique augmente, de fait, de 175% ! La part de l’huile prélevée pour la Finance publique a augmenté bien davantage que la production d’huile. Prélevé de 18230€ en 1990, le PIB/emploi l’est de 39590 € en 2022. L’augmentation des PO sur le PIB/emploi « surperforme », celle du PIB (+149%), celle du PIB/emploi (+95%) et celle du PIB/habitant (+114%). Et cela ne suffit pas, il faut encore s’endetter (35,6% de PIB en 1990, 111,8% en 2022), une dette qui « roule » mais dont le service se paye avec les PO…
Tentative d’explication : les prélèvements, obligatoires et maléfiques ?
La « machine France » produit toujours plus et proportionnellement plus que n’augmente la population, mais elle produit trop peu d’huile pour alimenter les lampes de tous les foyers et « garder son rang » dans le classement mondial. Trois données illustrent notre « glissement progressif » : 7ème rang en termes de PIB, 13ème rang (OCDE) pour la productivité (PIB/heure travaillée), 25ème rang de niveau de vie (PIB/habitant). La machine, en sous-emploi, est mal réglée. L’égalité de contribution au PIB de l’industrie et l’administration publique, chacune contribuant pour 18%, illustre ce mauvais réglage. La première, créatrice nette de valeur ex-ante, emploie 3,3 millions de salariés ; la seconde emploie 5,7 millions d’agents publics, transforme et consomme des prélèvements sur la richesse créée pour participer ex-post à la création de PIB (ceci dit sans ignorer les externalités positives de l’action publique – infrastructures, enseignement, santé, sécurité, cadre institutionnel. Avoir choisi le modèle d’une économie sans usines, d’une économie de services aux emplois trop souvent peu rémunérés, c’était conforter encore un modèle de redistribution et rendre subsidiaire la distribution primaire à la production quitte à favoriser les trappes à bas salaires, la smicardisation.
Si la fin des Trente glorieuses marque un point de bascule, il en est un autre : celui du « temps libre » donné par anticipation sur les gains de productivité. Les salaires ne suivent plus, le travail perd de son sens (utilité). La Politique, servie par une politique fiscale de court terme, ignore la réalité de l’Économie. Le remède est comme la chloroquine : on l’administre sans voir qu’il ajoute au dérèglement de la machine !
Le diagnostic de la panne est-il le bon ? Comme en mécanique, le mélange serait trop riche de prélèvements devenus obligatoires, au regard de la production. En mécanique, il en résulte des « cliquetis » : dans le champ social, ce sont des mouvements sociaux. L’intervention de l’État est nécessaire, elle est « l’art de modifier, par voie de contrainte, la destination donnée à certaines richesses, en substituant des fins collectives, sociales ou morales aux fins individuelles que leurs maîtres leur eussent imposées dans leur souveraineté de propriétaire »[6]. Cet art, devenu happening permanent, n’a-t-il pas été poussé trop loin pour se faire keynésianisme social, keynésianisme de fonctionnement, keynésianisme de placébos ?
Boisguilbert, inspirateur de cette revue des détails, nous en suggère aussi la conclusion. Ce qui conduit au manque d’huile, c’est une méprise qui a pour effet que lorsque l’on voit une terre autrefois bien cultivée entièrement en friche c’est que les fruits, ne pouvant supporter quelque impôt nouveau il a fallu en abandonner la culture et anéantir par là tous ceux que le produit en faisait vivre[7] » … et Boisguilbert n’avait alors aucune idée de ce que serait un État providence !
Il est temps de rendre à Boisguilbert ce que Laffer s’est attribué ! Il est temps de donner de l’air à la machine !
Notes
[1] Le titre, ici tronqué, est « « Détail de la France, la cause de la diminution de ses biens ET la facilité du remède en fournissant en un mois tout l’argent dont le Roi a besoin et enrichissant tout le monde ».
[2] Sources : INSEE, séries chronologiques pour les données nationales. STATISTA pour les comparaisons internationales.
[3] Voir « Le produit intérieur brut par habitant sur longue période en France et dans les pays avancés : le rôle de la productivité et de l’emploi » – Antonin Bergeaud, Gilbert Cette, Rémy Lecat, in Economie et statistique, année 2024/ 474 p.5-34.
[4] « Dans quelle mesure les administrations publiques contribuent-elles à la production nationale ? » , Le blog de l’INSEE, 3 décembre 2021.
[5] « La redistribution élargie … » – Mathias André, Jean-Marc Germain, Michaël Sicsic, INSEE analyses n°88, 19/09/2023.
[6] J. Rueff cité par Arnaud Diemer in « La place des institutions dans le courant néolibéral français : de Jacques Rueff et Louis Rougier à Maurice Allais », colloque de l’Association Charles Gide pour l’étude de la pensée économique, « Les institutions dans la pensée économique », 27-29 mai 2010.
[7] In « Le détail de la France, la cause de la diminution de ses biens » p.151.