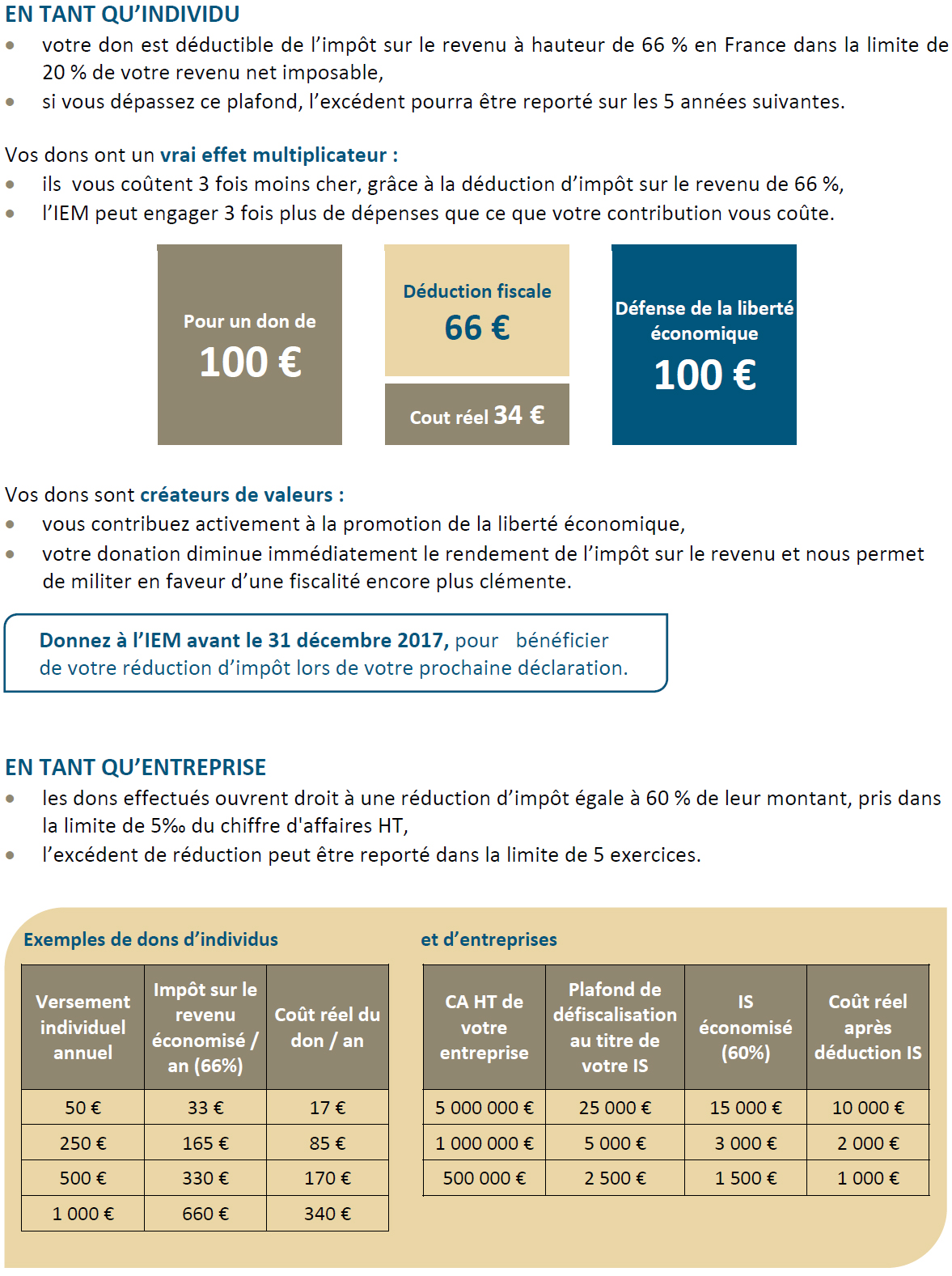Les vertus du vice
Éditorial de Pierre-Antoine Delhommais publié le 27 mars 2014 dans Le Point.
Les taxes «comportementales» répondraient à un impératif de santé publique. Pas sûr…
En 1791, pendant que les Français faisaient la Révolution, des milliers de fermiers de l’ouest des États-Unis se révoltaient aussi. Pas contre un roi, mais contre une taxe fédérale sur le whisky destinée à combler le déficit budgétaire et à lutter contre les ravages de l’alcoolisme. Trois ans plus tard, le président George Washington envoya la troupe pour mater les révoltés du whisky.
La «Whiskey Rebellion» marque une date importante dans l’histoire de la «fiscalité comportementale». Derrière cette expression un peu pompeuse utilisée par les économistes se cache une réalité beaucoup plus simple : la taxation des vices. Le spectre de ces derniers étant extrêmement large, les experts limitent habituellement la fiscalité comportementale aux impôts poursuivant directement des objectifs de santé publique (lutte contre l’obésité, le tabagisme et l’alcoolisme), en excluant du coup ceux sur les jeux ou l’industrie du sexe.
Dans un récent rapport consacré aux taxes comportementales, la commission des Affaires sociales du Sénat en a recensé en France pas moins de onze. Qui vont de la contribution sur les boissons énergisantes au droit de consommation sur le tabac en passant par les accises sur les poirés et les hydromels. La liste s’allonge chaque année, comme les recettes qu’en retire l’État : 14,8 milliards d’euros en 2012, 15,3 milliards en 2014.
Avec le double et noble objectif de rendre et l’État et les citoyens plus vertueux, la fiscalité comportementale obéit dans le même temps à des préoccupations hautement morales et bassement matérielles et comptables. En prônant tout à la fois l’hygiène budgétaire et l’hygiène de vie tout court, en prétendant lutter d’un même élan contre les déficits de l’État et les vices des individus, elle apparaît d’une certaine façon, si l’on ose cette parenté extrêmement osée, comme l’enfant naturel de la chancelière Merkel et du pape François.
Au XIXe siècle, politiciens et économistes avaient abondamment théorisé, pour mieux la justifier, la taxation des vices. Le ministre de l’Instruction publique et des Cultes, Félix Esquirou de Parieu, expliquait ainsi que «l’impôt sur l’eau-de-vie présente un de ces exemples assez rares dans lesquels l’établissement des taxes peut être éclairé et dirigé par une pensée morale». En Allemagne, l’économiste Karl David Heinrich Rau affirma que «l’eau-de-vie est une excellente matière imposable, parce que son usage devient aisément excessif, se change promptement en habitude et devient si dangereux pour l’esprit et le corps que le législateur doit désirer de restreindre sa consommation par l’élévation de son prix». Beaucoup plus récemment, en 1983, Pierre Bérégovoy, ministre des Affaires sociales, avait défendu la création d’une «cotisation sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l’usage immodéré de ces produits pour la santé».
Sur fond d’assainissement simultané des comptes publics et des modes de vie, la fiscalité comportementale connaît, depuis plusieurs années, un développement fulgurant. Et l’imagination des hygiéno-fiscalistes semble sans limite. Il y a deux ans, il avait même été question d’instaurer une taxe sur les barres chocolatées, mais le gouvernement y avait renoncé in extremis, redoutant probablement la colère des révoltés du Bounty.
Selon une étude citée par Valentin Petkantchin, de l’Institut économique Molinari, ces taxes représentent 11,4% du revenu des ménages britanniques les plus modestes, une part deux fois plus élevée que celle des ménages les plus aisés.
Un certain nombre de citoyens mais aussi d’économistes – de toutes tendances, pour une fois – dénoncent les abus de la fiscalité comportementale, qui selon eux nuit gravement à la santé économique d’un pays. À gauche, on met en avant son caractère profondément inégalitaire. Selon une étude citée par Valentin Petkantchin, de l’Institut économique Molinari, ces taxes représentent 11,4 % du revenu des ménages britanniques les plus modestes, une part deux fois plus élevée que celle des ménages les plus aisés. Les libéraux, eux, dénoncent les effets pervers de ces taxes : en renchérissant artificiellement le prix d’un produit, elles favorisent automatiquement la création de trafics en tout genre, sans effet avéré sur la consommation globale. Mais ce sont surtout les atteintes aux libertés individuelles qui les émeuvent ; le fait que l’État oblige les citoyens non seulement à vivre d’une certaine façon, mais aussi leur indique de quoi ils doivent mourir. Avec une culpabilisation permanente pour tous ceux qui préfèrent les rillettes au tofu, le bourgueil au jus de carottes et un havane à une cigarette électronique.
Quant à l’argument massue de l’énorme coût que représentent les vices individuels pour la collectivité, il est vivement contesté. Pourquoi ? Parce que les gens qui vivent de façon saine vivent vieux, très vieux, nettement plus vieux que les accros au tabac ou au p’tit blanc sec. Or les dépenses de santé augmentent de façon exponentielle avec l’âge : 1 500 euros par an en moyenne à 50 ans, 2 500 à 60 ans, 4 000 euros à 70 ans, 6 000 euros à 80 ans. «Si on vit plus longtemps, on coûte plus cher au système de santé.» Tel est le constat abrupt fait par Pieter Van Baal, économiste à l’Institut de santé publique des Pays-Bas, auteur d’une très sérieuse et très complète étude sur le coût comparé des dépenses de santé, à l’échelle d’une vie, entre un fumeur, un obèse et un individu mince et non fumeur : celles d’un fumeur atteignent 220 000 euros, celles d’un obèse 250 000 euros, celles d’un healthy-living 281 000 euros ! En un mot, ce sont les buveurs d’eau, les mangeurs de bio et les fous de jogging qui plombent les comptes de la Sécu.
Aux strictes dépenses de santé d’autres économistes n’hésitent pas à ajouter le coût des retraites et des frais de dépendance vieillesse, d’autant plus élevés, par définition, que les gens meurent plus âgés. Une étude menée aux États-Unis est arrivée à cette conclusion pas du tout politiquement correcte : l’achat d’un paquet de cigarettes fait globalement «économiser» 0,32 dollar au pays. On laissera les buveurs et les fumeurs savourer sans modération les résultats de ces études de nature à soulager leur conscience citoyenne : leurs vices favoriseraient la vertu budgétaire, leurs addictions coupables contribueraient très efficacement au redressement des comptes publics.
Pierre-Antoine Delhommais est un journaliste économique français. Il est éditorialiste au Point et chroniqueur économique au journal Le Monde.