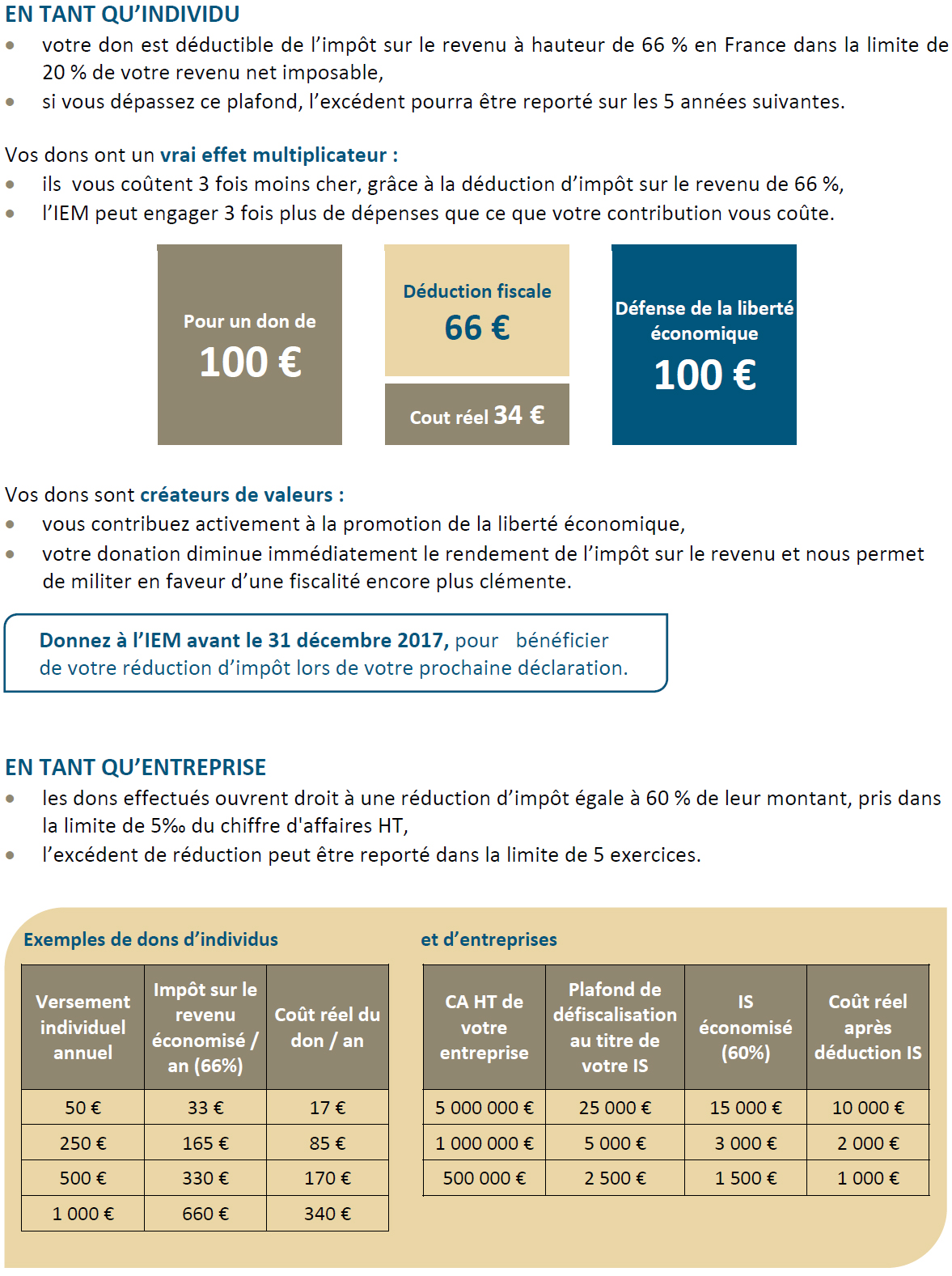Les conséquences cachées des tests de résistance des banques
Texte d’opinion publié le 28 novembre 2012 sur 24hGold.
Les tests de résistance des banques sont devenus un outil de routine pour les superviseurs bancaires. Ils consistent à estimer, sous un ensemble d’hypothèses relatives à l’environnement macroéconomique anticipé, les besoins en capitaux propres d’une banque sur les trois années à venir. Après comparaison de ces besoins avec les fonds propres existants, les superviseurs imposent à la banque de lever les fonds nécessaires afin de combler la différence, s’il en est une. Cette mesure de contrôle prudentiel de la résistance des banques aux chocs futurs contribue-t-elle véritablement à la stabilité financière? Ou est-ce plutôt un exemple de dirigisme économique, dont il nous faudra examiner les conséquences cachées?
Le rôle des capitaux d’une banque est d’amortir les chocs liés aux variations de valeur de ses actifs, principalement des prêts bilatéraux aux entreprises et aux ménages et des obligations marchandes émises par les États et les entreprises. Le niveau des capitaux est donc variable. Les gains sur les actifs, y compris les revenus courants liés aux intérêts sur les prêts et obligations, augmentent les capitaux propres. A contrario, les pertes les diminuent.
Cette possibilité d’érosion, partielle ou totale, des capitaux propres pose tout naturellement la question de leur « bon » niveau. Combien de capitaux propres une banque devrait-elle avoir? C’est précisément cette question que les tests de résistance des banques se proposent d’éclairer. Leur réponse consiste à dire qu’une banque doit avoir assez de capitaux pour qu’à la suite des pertes attendues sur les trois années à venir, les capitaux propres représentent au minimum 6% de ces actifs pondérés au risque. Pour en comprendre les répercussions, essayons d’imaginer comment cette problématique serait adressée sur un marché libre.
Sur le marché, personne n’aurait la prétention de connaître ni l’environnement macroéconomique futur ni la profitabilité attendue des banques sur les trois années à venir. Les propriétaires d’une banque essaieraient plutôt d’éviter la perte de confiance de leurs clients et la faillite en suivant des règles de conduite éprouvées par le temps. C’est la hausse du coût de ses emprunts, ou de l’intérêt qu’elle doit payer pour attirer des dépôts qui servent de signal. Ils indiqueraient que l’activité de la banque commence à être jugée plus risquée, et que par conséquent elle devrait lever plus de fonds. En un mot, c’est le système des prix qui déterminerait le bon niveau de capitaux.
Les tests de résistance font fi du système de prix qu’ils remplacent par une approche administrative de la gestion bancaire. Des personnes externes à la banque calculent les besoins en capitaux, sans y être ni créditeurs, ni déposants, ni propriétaires, et avoir un intérêt personnel à la santé de l’établissement financier. Elles sont certes expertes mais ne risquent jamais leur propriété dans leur calcul. Cette prétention de connaissance suprême mise à part, une telle approche administrative contribue à la collectivisation du système financier.
Premièrement, en imposant à la banque un montant particulier de fonds propres, les superviseurs imposent, de fait, un prix minimum sur les actifs de l’établissement. Cette imposition est sans importance pour les banques qui passent le test, et qui n’ont donc pas besoin de lever des fonds supplémentaires. Pour ces banques, les investisseurs considèrent que la valeur de marché de leurs actifs est supérieure au prix minimum décrété de fait par les superviseurs. Les choses se corsent pour les établissements qui ne passent pas le test. En effet, ces banques n’ont pas de chance d’attirer des investisseurs privés qui y auraient déjà pris des positions s’ils anticipaient qu’ils pouvaient en profiter. En imposant à la banque de lever des fonds supplémentaires, le superviseur décrète un prix minimum de ces actifs au-dessus de leur valeur de marché. Comme le plan d’augmentation du capital est voué à l’échec, l’État doit intervenir pour combler la différence, et nationaliser partiellement ou totalement la banque. Sa gestion, et sa restructuration, lui incombe dorénavant.
Deuxièmement, ce mode opératoire empêche la restructuration de la banque, et conduit par conséquent à des malinvestissements futurs. Sur le marché, où chaque investissement n’est qu’une question de bon prix pour le bon risque, ce sont les nouveaux investisseurs qui imposeraient la restructuration voulue, et nécessaire, aux activités de la banque. Dans le pire des cas où la banque se serait retrouvée avec des capitaux négatifs, ils demanderaient, pour et avant d’investir, que les créditeurs et déposants s’associent à l’effort de redressement en renonçant à une partie de leur créance sur la banque, ce qui permettrait de combler le trou négatif. Une fois sous tutelle de l’État, une telle restructuration de fond en comble n’est plus nécessaire, et la participation des créanciers n’a plus de raison d’être. Le gouvernement, tant que sa propre condition financière n’est pas en jeu, peut financer la banque par des impôts, et prolonger et ralentir le processus de restructuration.
Au fonds, les tests de résistance des banques ne sont donc qu’un prétexte à la nationalisation des banques en difficultés et à la mutualisation forcée de leurs pertes par tous les contribuables, qu’ils en soient créditeurs ou non. Plutôt que d’assurer la stabilité financière, ces tests sont un outil de l’intervention étatique qui a pour but de maintenir en vie des établissements financiers qui devraient être fermés.
Siméon Brutskus a vécu sa jeunesse à l’Est, avant de parfaire son éducation économique en France. Sa carrière d’enseignant-chercheur l’a conduit à s’intéresser à la théorie et politique monétaires, et au rôle qu’occupent les banques centrales dans la déstabilisation des systèmes financiers.