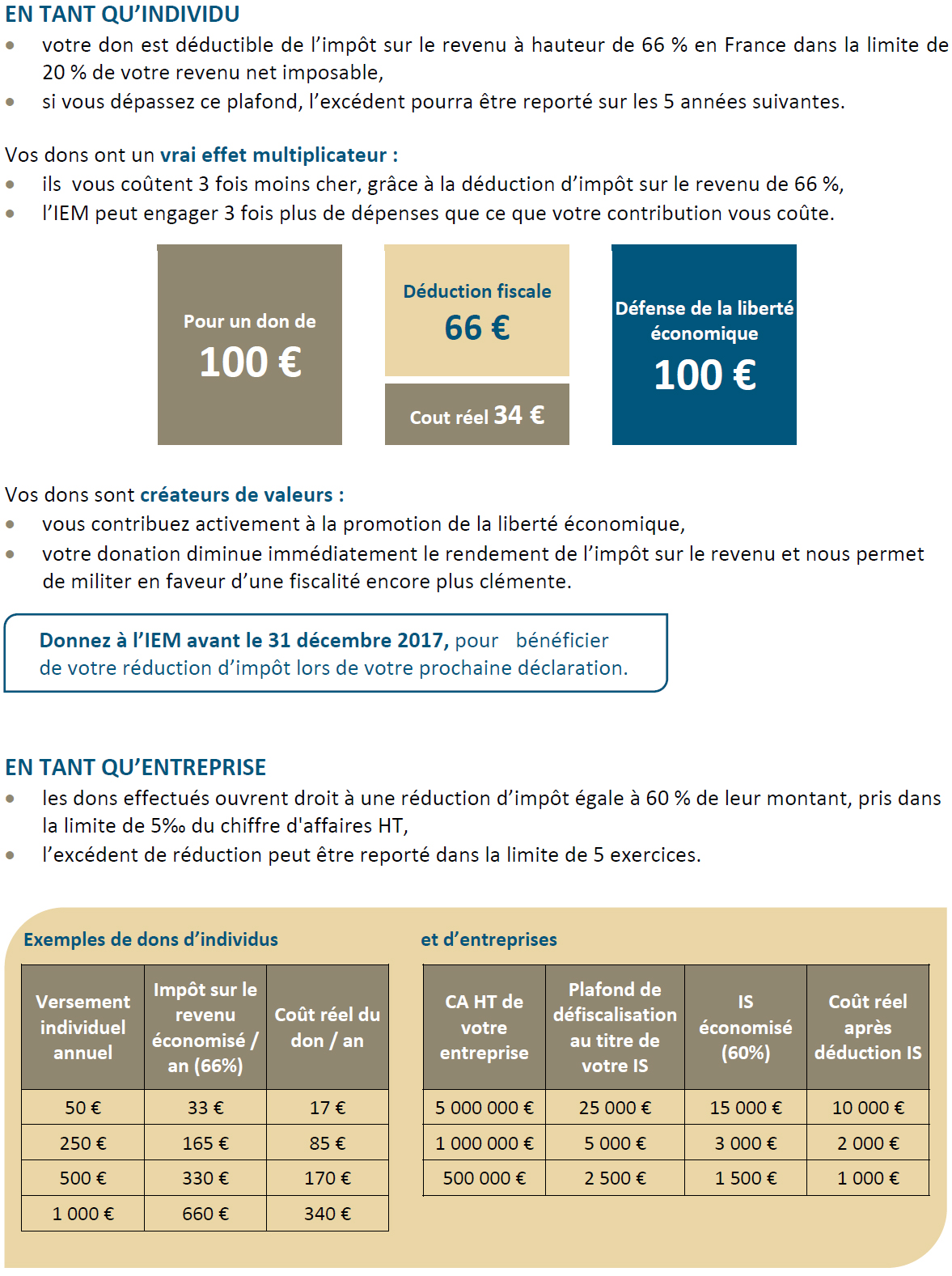« C’est une crise de l’interventionnisme monétaire et financier »
Article publié dans l’édition d’avril de l’Hulsmann0409.pdf« >AGEFI Magazine.

Pour l’économiste allemand Jörg Guido Hülsmann, la solution pour sortir de la crise ne passe pas par une règlementation plus stricte, mais par une responsabilisation des épargnants et des investisseurs et par un système monétaire plus libre.
Propos recueillis par Noël Labelle
Nous connaissons une crise financière et économique d’une ampleur et d’une durée inconnues. Sommes-nous capables aujourd’hui d’en identifier objectivement les principales causes ?
Jörg Guido HülsmannIl est vrai que l’ampleur de la crise a surpris la grande majorité des économistes, journalistes et analystes financiers. Cependant, il y avait aussi des voix qui ont annoncé la débâcle actuelle, et ce depuis une quinzaine d’années au moins. Même si elles n’ont pas réussi à pronostiquer la date exacte de l’éclatement de la crise, au moins ont-elles eu le mérite d’expliquer pourquoi son avènement serait inévitable.
Ceux qui ont anticipé la crise tombent grosso modo dans deux camps. Les uns voient la principale cause de la crise dans la montée du capitalisme, qui par sa nature serait effréné et irrationnel. Selon eux, la libéralisation des marchés financiers depuis la fin des années 1970 aurait encouragé des prises de risque irresponsables. Ils recommandent par conséquent de revenir en arrière, de nationaliser une grande partie de l’industrie financière et de resserrer la réglementation.
D’autres économistes proposent une lecture et des remèdes diamétralement opposés. Ils admettent que les prises de risque sur les marchés financiers ont été bien souvent irresponsables. Les banques et les entreprises d’investissement ont depuis longtemps affaibli les soupapes de leur gestion financière, en réduisant les fonds propres et en diminuant la part de la trésorerie dans leurs actifs. De plus, elles ont systématiquement préféré des placements à plus haut risque (donc plus grande rentabilité) au détriment des placements moins risques (et donc moins rentables). Il en résultait une fragilisation des marchés financiers dans leur ensemble. Mais ces comportements ne sont pas tombés du ciel. Ils ne sont pas innés au capitalisme. Leur véritable cause réside dans notre système monétaire étatisé. Ce système est basé sur le papier-monnaie et la monnaie électronique – des types de monnaie qui facilitent le financement de l’État par la dette, mais qui encouragent en même temps des choix d’investissement irresponsables.
Je crois que cette analyse est essentiellement correcte. En effet, les agents intervenant sur les marchés financiers savent que les banques centrales produisent la « monnaie de base » de l’économie, et que cette production se fait sans aucune limitation technique ou commerciale. Ils savent que, grâce à ce puissant outil, les banques centrales peuvent empêcher des crises de liquidité en prêtant sans limite aux entreprises en difficulté de paiement. Ils savent également que, grâce à cet outil, les banques centrales peuvent stabiliser les cours des titres financiers. Finalement, ils savent que ces pouvoirs ne sont pas purement hypothétiques car, dans le passe, les banques centrales les ont utilisés ; et puisqu’ils écoutent très attentivement les discours du Pr. Bernanke et de M. Trichet, ils savent aussi que les banques centrales ont l’intention de stabiliser les paiements et les cours des titres financiers à tout jamais. Clairement, cette « assurance tout risque » monétaire incite les agents financiers à diminuer leurs propres précautions. Ils ont tout intérêt à diminuer leur trésorerie et leur fonds propres, afin d’augmenter la rentabilité de leurs placements. Cela est certes catastrophique du point de vue macroéconomique, mais pas du tout irrationnel du point de vue des agents. C’est bien au contraire un comportement très rationnel, étant données les incitations créées par les institutions politiques en place.
L’on comprend alors pourquoi les marchés financiers ont littéralement été balayés par la crise une fois qu’elle était en route. Mais les incitations perverses créées par notre système monétaire expliquent aussi pourquoi on ne pouvait pas empêcher qu’elle se mette un jour en route. En effet, une assurance tout risque monétaire crée des bulles spéculatives avec leurs revenus et richesses imaginaires. Entre 1995 et 2006, deux grandes bulles – boursière et immobilière – se sont succédées aux États-Unis et ailleurs, et ces bulles ont laissé une forte empreinte sur la division du travail à l’échelle mondiale. Elles ont redirigé les investissements en Chine, en Europe et aux États-Unis envers la satisfaction de consommateurs à richesse imaginaire. On érigeait des usines, on montait d’entières filières de production, on refaisait le commerce international – jusqu’en juillet 2007, lorsque la bulle immobilière éclatait dans son maillon le plus faible, celui des crédits subprime. Mais cet éclatement ne pouvait pas rester un problème des seuls marchés financiers. Il mettait en cause la rentabilité d’un grand nombre de projets industriels
(automobile, informatique etc.) ainsi que la solvabilité des entreprises concernées.
Le problème principal soulevé par la crise est donc de remanier non seulement les placements financiers, mais surtout les investissements industriels. En raison des interdépendances entre tous les producteurs, les dépenses des uns étant les revenus des autres, il faut en effet tout remanier à l’échelle mondiale. L’ampleur et la complexité du défi étant énormes, les nouveaux équilibres mondiaux encore inconnus, a l’heure actuelle les investisseurs doivent avancer prudemment par un processus de tâtonnements. C’est ce processus pénible qui se déroule sous nos yeux, et on est loin d’être arrivé à son creux. Même dans les circonstances les plus favorables, il va durer encore cinq à six ans, si l’on peut généraliser les expériences historiques.
A l’automne dernier, les États sont intervenus massivement pour tenter de calmer les marchés, mais cela n’a rien donné. Pourquoi ?
D’abord, on est intervenu par des interventions monétaires. Mais la politique monétaire traditionnelle, qui augmente la masse monétaire en octroyant des crédits bon marché, ne fonctionne que dans les crises de liquidité. Elle est impuissante face à des crises de solvabilité. Vous ne sauvez pas une entreprise insolvable en lui proposant un crédit, même à zéro pour cent.
Donc on a changé de stratégie. Au lieu d’encourager les dépenses du secteur privé par une plus grande facilité du crédit, on s’est retourné vers l’orthodoxie keynésienne, qui préconise des dépenses directes de l’État. Si l’État achète des actions d’entreprises en difficulté (nationalisation partielle ou complète) il peut effectivement empêcher qu’elles ne deviennent insolvables. Même résultat lorsque l’État se met à acheter les produits des entreprises en danger d’insolvabilité.
Mais ceci n’est toujours pas une solution du problème auquel nous sommes confrontés, à savoir, le remaniement de la structure industrielle. Les industries automobiles et autres qui sont aujourd’hui en difficulté ont fait des investissements qui ne se rentabilisent que dans le monde des richesses imaginaires de la bulle financière. Ils ne se rentabilisent pas dans le monde réel, tel qu’il se présente à la lumière froide de la crise. Donc, ce que font les dépenses de l’État, c’est d’alimenter artificiellement certains projets d’investissement qui n’ont pas de raison d’être économique, c’est-à-dire qui gaspillent nos ressources productives – travail, matières premières, outils – au lieu de les reproduire. Voila pourquoi les marchés financiers ne se calment pas. Les investisseurs sont évidemment contents lorsque les subventions de l’État jouent en leur faveur, mais ils sont loin d’y voir la solution de nos problèmes actuels.
Les politiques de relance sont-elles donc vouées à l’échec ?
Effectivement. Ces politiques n’ont jamais fonctionné. Elles n’ont pas fonctionné au temps de la Grande Dépression aux États-Unis, un fait reconnu aujourd’hui par la majorité des historiens américains. Elles n’ont pas donné un nouvel essor à l’économie est-allemande, étouffée par plus de cinquante ans de socialisme. Elles n’ont pas fonctionné au Japon après la crise boursière de 1990-91. Elles n’ont jamais fonctionné nulle part. Leur véritable fonction est d’ordre psychologique et politique : le gouvernement souhaite rassurer la population en «faisant quelque chose». Mais d’un point de vue économique, on crée alors des dégâts supplémentaires au lieu d’apporter des solutions.
Doit-on penser que le pire est encore à venir ?
Oui, parce que pour le moment nos gouvernements ont tout fait pour empêcher des changements significatifs, tandis qu’il s’agirait précisément de refaire nos économies pour les adapter aux nouvelles circonstances. En 2009, on va continuer encore sur la mauvaise voie puisque le gouvernement américain est déterminé à mettre en place son grand programme de dépenses. Donc il ne faut pas espérer atteindre le creux de la crise avant 2010 ou 2011.
Est-ce une crise du système ou une crise du fonctionnement du système ?
C’est une crise de l’interventionnisme monétaire et financier. J’ai grande estime pour les compétences techniques de nos autorités monétaires, et j’admire l’intelligence et la créativité des entrepreneurs financiers. Mais tous leurs talents n’ont pas su faire marcher un système basé en fin de compte sur l’irresponsabilité. Ils ont seulement pu reporter l’éclatement de la crise, cependant, au prix d’en faire une crise énorme puisque les déséquilibres se sont accrus.
De plus, n’y a-t-il pas aussi un problème psychologique, une perte de confiance de la part des principaux acteurs du système financier ? Comment peut-on l’expliquer ?
La perte de confiance est le facteur immédiat qui entraine l’effondrement de la finance basée sur la dette, mais ce n’est pas le facteur ultime. En fin de compte les agents financiers sont confiants pour autant que leurs investissements réussissent. Dans l’environnement actuel, ils ne devraient pas être confiants, sous peine de gaspiller leur capital et les ressources rares dont dépend l’avenir de tout le monde.
Quelles seraient, selon vous, les solutions pour sortir de cette situation générale ?
Il faudrait abandonner l’interventionnisme monétaire et financier. Donc surtout pas de dépenses et de garanties de l’État dans le vain espoir de relancer l’économie. La manière la plus efficace et la plus rapide de nous sortir de la crise consiste à responsabiliser les épargnants et les investisseurs et à les laisser faire. Il y aurait des banqueroutes immédiates et massives, et un effondrement assez complet de nos marchés financiers. Par conséquent la dette privée disparaitrait très largement et les entreprises seraient dans les mains de nouveaux dirigeants ; les investissements non rentables seraient vite abandonnés et le remaniement de la production industrielle serait mis en route.
Cette politique de « laisser-faire » ne provoquerait-elle pas des dégâts immédiats plus importants ?
Effectivement. Elle aurait des conséquences diamétralement opposées à celles des politiques en cours, qui sacrifient le bien-être social à long terme sur l’autel de l’apaisement de tout le monde à court terme. Le laissez-faire provoquerait dans une première phase (2 à 3 ans) un très grand chômage et des banqueroutes massives. Puis, dans une deuxième phase, il y aurait une relance qui se ferait d’abord lente pendant 2 à 4 ans, et ensuite de plus en plus vigoureuse.
Certains citoyens seraient incapables de survivre à la première phase de leurs propres forces, donc il faudra les aider. Mais les sommes nécessaires à cette fin seraient bien moindres que les montants qui disparaissent à l’heure actuelle dans le grand gouffre que sont devenus les marches financiers.
Une politique monétaire différente est donc également à envisager ?
Si dans quelques années nous sortons de la crise sans avoir modifié à fond notre politique monétaire actuelle, nous serons déjà sur le chemin qui mène vers la crise financière suivante. On ne pourrait pas l’empêcher par une réglementation plus stricte. Les marchés financiers sont déjà parmi les plus réglementes, comparables à cet égard uniquement avec le secteur de la santé.
Certains pensent qu’il y a toujours trop d’activités financières qui ne sont pas ou pas suffisamment réglementées. Soit. On pourrait effectivement en finir avec les dernières libertés qui subsistent sur les marchés financiers et les bureaucratiser à fond par une réglementation complète. L’on créerait ainsi un système plus stable que le système actuel. Mais cette stabilité serait celle d’un cimetière. Le maillon central de l’économie de marché serait complètement socialisé, politisé et inefficace.
Ceux qui ne souhaitent pas recourir à cette solution totalitaire doivent en finir avec le système actuel. Des réglementations partielles ne seraient pas suffisantes puisqu’elles maintiennent les irresponsabilités des agents financiers – des investisseurs privés et publics et des intermédiaires – qui quitteraient simplement les segments réglementés et se dirigeraient vers des segments non réglementés, comme ils l’ont fait pendant les trente dernières années. Pour en finir avec l’irresponsabilité systématique qui pervertit le fonctionnement des marchés financiers, il faut en finir avec notre modèle monétaire axé sur le papier-monnaie et sur la monnaie électronique.
La solution la plus cohérente serait celle de la liberté monétaire complète. On rend aux citoyens le droit de choisir la monnaie qui leur plaît, et de produire des monnaies nouvelles s’ils ne sont pas satisfaits des autres. La conséquence serait très probablement un retour à l’emploi monétaire des métaux précieux : l’argent et l’or. L’irresponsabilité sur les marchés financiers disparaitrait puisque l’argent et l’or ne peuvent pas être multipliés par l’arbitraire de quelques autorités. Leur production serait soumise à la contrainte de la rentabilité des mines.
Une autre solution, plus problématique, consisterait à rétablir la convertibilité de nos monnaies actuelles en argent ou en or. Tel fut la solution retenue par l’Italie, l’Autriche et la Russie au XIXe siècle. C’est une solution imparfaite puisqu’elle n’en finit pas avec l’arbitraire des banques centrales, mais elle serait bien supérieure au système actuel.