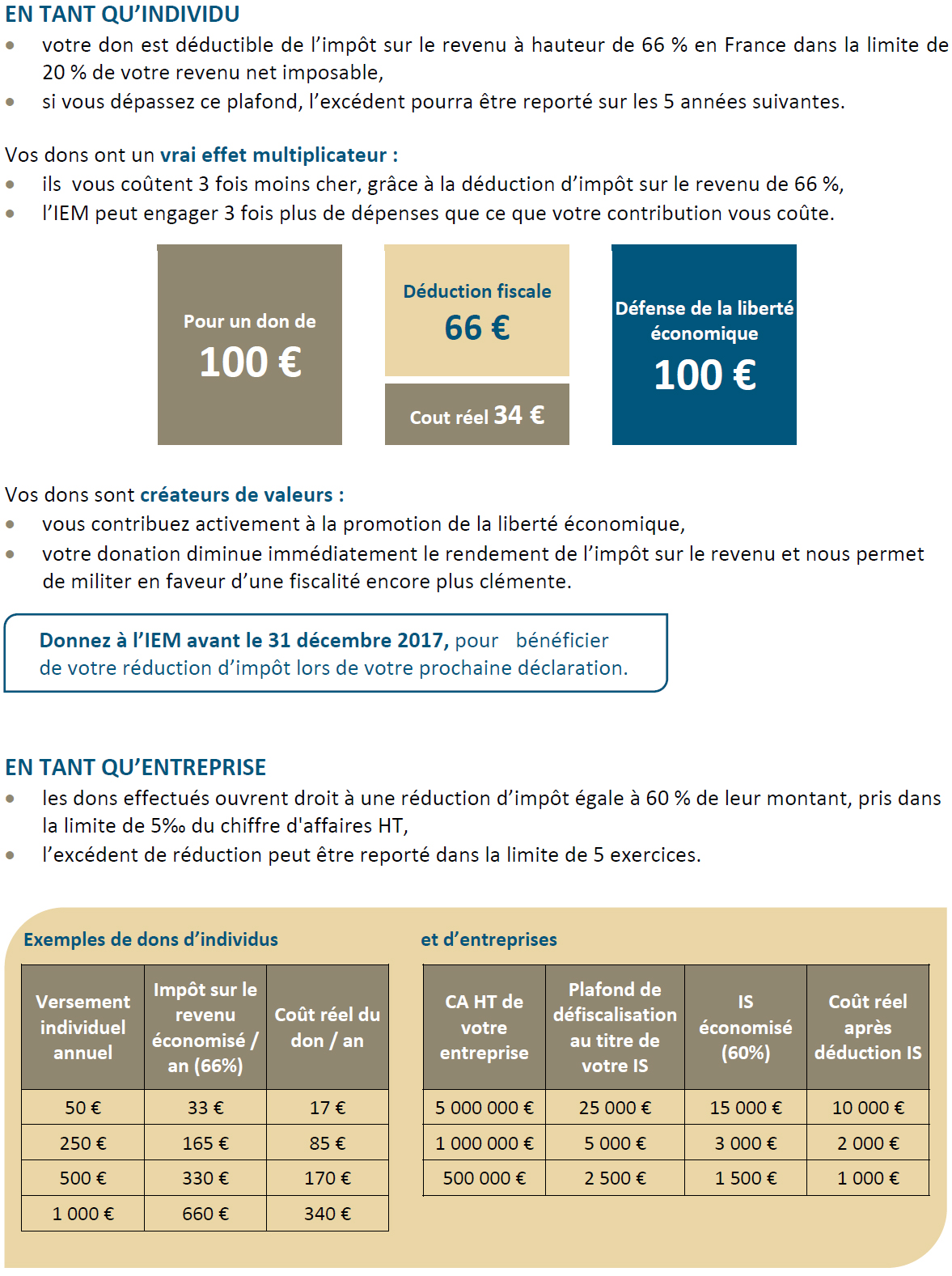La France, championne de l’impasse fiscale et cancre du non fiscal
Un grand nombre de pays financent une partie de leurs services publics et, en particulier, leur protection sociale grâce à des recettes extra-fiscales. Pas nous. Texte d’opinion par Cécile Philippe et Nicolas Marques, respectivement présidente et directeur général de l’Institut économique Molinari, publié dans L’Opinion.
Coup de tonnerre à l’Assemblée nationale, une alliance entre la gauche et le Rassemblement National vient de voter une hausse radicale de la fiscalité sur les multinationales. Le gouvernement est horrifié. Ils tuent l’attractivité, ce qui va, in fine, détruire des emplois souligne, à juste titre, Roland Lescure, le ministre de l’Économie. Mais les extrêmes ne sont pas les seuls à avoir joué sur cette pente glissante.
Il y a quelques jours, des députés soutenant le gouvernement proposaient, comme ceux de LFI, de porter le taux de la taxe numérique française de 3 à 15 %. Des niveaux qu’on ne trouve que dans des pays extra-européens abusant des fiscalités sectorielles. Cette semaine, l’Assemblée a opté pour une augmentation moins maximaliste, en doublant la taxe numérique, mais cet épisode confirme qu’en matière de fiscalité, les extrêmes ne sont pas les seuls sans repères.
Surtout, qui ne se souvient pas de Bruno Le Maire, l’ancien ministre de l’Économie de 2017 à 2024, expliquant à répétition qu’il fallait taxer plus les multinationales, au motif qu’elles payaient moins d’impôts que les TPE françaises ? C’est exactement l’argument évoqué par ceux qui proposent aujourd’hui d’augmenter leur fiscalité. En 2019, lorsque Bruno Le Maire s’est fait le héraut de la taxe numérique, peu de monde soulignait que ses éléments de langage masquaient nos travers.
Pourtant, à rebours du narratif officiel, nos calculs montraient que les géants du numérique supportaient une fiscalité en ligne avec celle des grandes entreprises européennes. Le différentiel fiscal en défaveur des TPE françaises était directement lié à la dureté de notre cadre fiscal national qui pénalise particulièrement les petites entreprises. Et le ministre se gardait bien d’expliquer que la taxe numérique serait au final supportée par les consommateurs. Pourtant, la fiscalité ruisselant du fort au faible, il était évident que les géants du numérique allaient la répercuter directement ou indirectement sur les ménages.
En focalisant ses efforts sur la taxation des multinationales au détriment d’autres sujets clefs, la France a fait un choix hasardeux. Elle a parié sur une révision des règles de fiscalité internationale, sujet éminemment complexe qui ne fait pas l’unanimité. Elle a fait l’impasse sur le levier qu’elle pouvait actionner, le développement de ses recettes non fiscales.
Un grand nombre de pays financent une partie de leurs services publics et, en particulier, leur protection sociale grâce à des recettes extra-fiscales. C’est un domaine sur lequel nous sommes très en retard, ce qui explique la dégradation de nos finances publiques. Dans les pays qui ont généralisé la capitalisation, une partie significative des retraites est financée par les gains générés par les placements financiers. La fiscalité y est moindre, car les fonds de pension sont une alternative à l’impôt. Ils redistribuent une partie des profits des entreprises dans lesquelles ils investissent.
Ce canal de socialisation des bénéfices permet de redistribuer une partie des bénéfices des entreprises multinationales sans passer par la case impôt et permet de ne pas dépendre d’une hypothétique révision des règles fiscales internationales. Si nous étions dans la moyenne des pays de l’OCDE, l’épargne retraite rapporterait près de 80 milliards d’euros par an de recettes non fiscales, sous la forme de dividendes et plus-values.
Faute d’avoir développé ce volet – en généralisant la capitalisation collective dans le secteur privé et en provisionnant les retraites des fonctionnaires – les gouvernements successifs ont entériné notre dépendance à la fiscalité, une erreur stratégique. Croire en la toute-puissance de la taxe, ce qui empêche de voir les alternatives pragmatiques, est malheureusement un travers largement partagé.