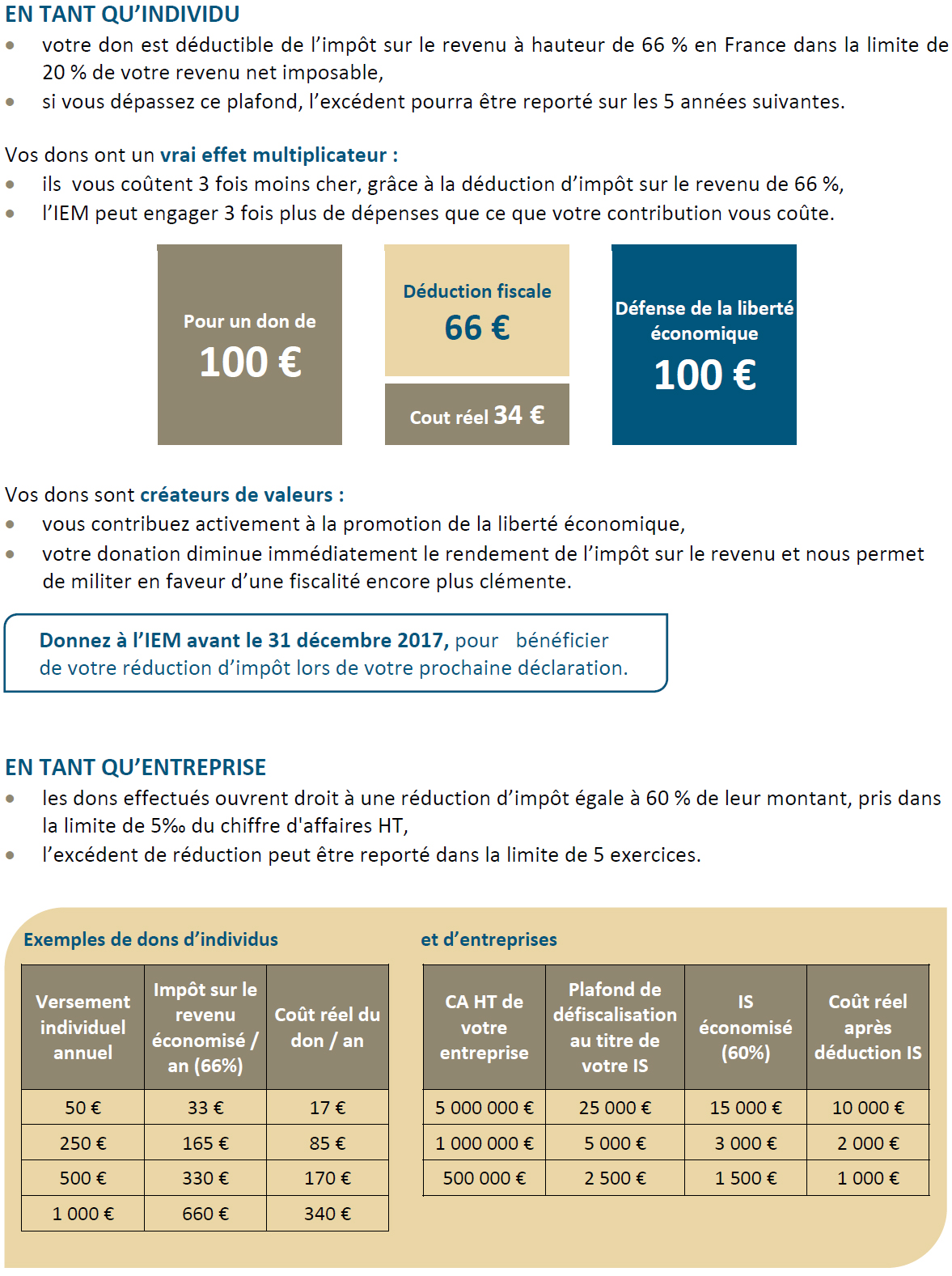Généraliser la capitalisation est un impératif social
Nicolas Marques, directeur général de l’Institut économique Molinari, revient sur la nécessité de réformer en profondeur le système de retraites. La version longue d’un échange avec Éric Revel publié dans Valeurs actuelles le 29 octobre 2025.
Que signifie la nouvelle dégradation de la note française par Standard & Poor’s après la « suspension » de la réforme des retraites imposée par le Parti Socialiste?
Elle montre qu’à force de ne pas traiter les sujets structurels, ou de les traiter à la marge, nous risquons de générer une perte de confiance chez ceux qui nous financent.
Les retraites, qui expliquent plus de 40 % de la hausse des dépenses publiques et des déficits depuis la fin du baby-boom, sont la raison principale de nos dérapages financiers. Elles sont devenues un facteur majeur d’instabilité politique. Ce n’est pas un hasard si, depuis 1974, nous n’avons jamais équilibré les comptes publics et si les déficits sont toujours croissants. C’est parce que notre pays vieillit et nous n’avons rien fait pour éviter que le financement inadapté des retraites ne déstructure l’économie et les finances publiques.
Le débat parlementaire enfle justement sur la réforme des retraites. Cette réforme n’est ni abrogée ni suspendue. Quels sont les impacts de cette incroyable confusion?
Si la réforme est mise en pause jusqu’à la présidentielle, l’âge légal de départ à la retraite restera à 62 ans et 9 mois. En 2027, le coût sera de 1,8 milliard pour les caisses de retraite et au global de 3 milliards pour l’ensemble des finances publiques. Moins de personnes au travail, c’est moins de recettes pour la Sécurité Sociale en général et pour l’État.
Si la réforme était abandonnée à l’issue de la présidentielle, le coût serait de 20 milliards par an en 2035. La moitié serait supportée par les caisses de retraite et le reste par les autres administrations publiques.
Le poids des retraites dans le total des prestations sociales est important. Certains considèrent les retraités comme des nantis …quelles sont vos données?
Ceux qui présentent les retraités comme des nantis n’ont pas regardé les chiffres et n’ont pas compris l’ampleur du problème. Ils font abstraction des réalités et éludent le sujet de fond, la nécessité d’épauler la répartition en généralisant la capitalisation retraite.
En France, le retraité moyen a un niveau de vie (29 620 euros par an) inférieur de 11 % à celui des actifs ayant un emploi. Présenter les retraités comme des nantis n’a aucun sens, sauf à vouloir légitimer des mesures visant à augmenter leur fiscalité.
L’anomalie n’est pas le montant des retraites, qui représente en moyenne les deux tiers du salaire moyen, mais leur mode de financement. Nous vivons dans l’illusion qu’un financement intégral des retraites par répartition est encore possible. Mais, dans les faits, nous sommes sortis du tout-répartition, avec des retraites qui ne sont plus intégralement financées par les cotisations des actifs. Lorsque le nombre de retraités progresse plus vite que le nombre d’actifs, le tout-répartition conduit à fiscaliser toujours plus les actifs ou à reculer sans cesse le départ à la retraite, ce qui suscite inquiétudes et opposition. C’est de là que vient la multiplication des déficits au sein de certaines caisses de retraite mal gérées et la dégradation de plus en plus prononcée des comptes publics depuis la fin du baby-boom.
Ce ne sont pas les retraités qui sont responsables, mais l’État qui a été doublement défaillant. En tant que régulateur, il a été incapable de mettre en place une gouvernance responsable au sein de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de faire monter en puissance la capitalisation pour épauler la répartition. En tant qu’employeur, il a été incapable de mettre de l’argent de côté pour éviter que les retraites des fonctionnaires génèrent des déséquilibres financiers majeurs.
Faut-il désindexer les pensions de l’inflation ? Geler les hausses de ces pensions?
La priorité, c’est de tirer les conséquences de l’imprévoyance de l’État et d’y remédier. Dans le secteur privé, il faut réformer la gouvernance de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, le régime de base, pour que répartition ne rime plus avec déficits structurels.
Lorsqu’elle est pratiquée de façon responsable, la répartition ne donne pas lieu à des surenchères et elle est équilibrée. On le voit avec l’Agirc-Arrco. Les partenaires sociaux arrivent à financer les retraites complémentaires depuis 1947 sans jamais émettre de dettes. Ils se sont dotés d’une gouvernance responsable qui fait cruellement défaut dans les régimes de retraite gérés par l’État, soumis aux surenchères politiciennes.
L’État a fait l’erreur de laisser la Caisse d’assurance vieillesse sans gouvernance responsable. C’est cela qu’il faut corriger. Pour ce faire, la solution la plus pragmatique est de la confier aux partenaires sociaux. Ils auront à mettre en place les mesures de redressement, ce qui impliquera très probablement une indexation moins avantageuse des pensions. Mais il ne faut pas confondre finalité et moyen. L’enjeu, c’est la mise en place d’une gouvernance ayant de vraies marges de manœuvre à la CNAV.
Taxer les pensions pour rééquilibrer le système par répartition a-t-il un avenir? Un sens macroéconomique?
Taxer plus les retraités réduirait le déficit de l’État mais ne corrigerait pas les défaillances structurelles des caisses de retraite mal gérées. Et ce serait injuste vis-à-vis des bénéficiaires de caisses équilibrées dans le secteur privé (Agirc-Arrco des salariés, les caisses des professions libérales…) ou dans la fonction publique (ERAFP…) qui pratiquent la répartition de façon responsable, avec des réserves et des mécanismes d’ajustement financiers, ou ont recours à la capitalisation.
Le déséquilibre structurel entre actifs et retraités condamne le système actuel. La seule réforme des retraites de 2023, même appliquée, suffirait-elle?
Bien sûr que non. Le problème structurel – le sous-développement de la capitalisation – reste à traiter. Compte tenu de la démographie, il est impossible au XIXème siècle de financer des retraites généreuses intégralement en répartition. Si nous capitalisions pour la retraite comme nos voisins, nous aurions 80 milliards d’euros de plus chaque année pour financer les retraites futures et mieux réévaluer les pensions. Il ne serait pas indispensable de reculer toujours plus le départ à la retraite ou de rogner les pensions.
La loi Borne, et d’une manière générale toutes les réformes paramétriques qui l’ont précédée depuis la fin des années 1980, visent à réduire les dérapages financiers associés aux retraites. Mais elle ne permet pas de compenser les tendances démographiques à l’œuvre et la chute du pouvoir d’achat des futures générations de retraités. Dans un monde où le nombre d’actifs stagne et le nombre de retraités augmente, c’est impossible de financer les retraités intégralement en répartition, même en reculant très significativement la durée de la retraite. Si rien n’est fait, les retraités auront perdu 16 % de pouvoir d’achat par rapport au reste de la population entre le milieu des années 2010 et 2070. Retraite rimera avec frugalité, alors que tous auront cotisé significativement durant leur vie active. Les retraites seront un sujet encore plus explosif qu’aujourd’hui.
Alors, quelles sont les solutions?
Il faut généraliser au plus vite la capitalisation collective dans le secteur privé, en complément de la répartition et des dispositifs de capitalisation facultatifs existants. C’est ce qui a déjà été fait, il y a 20 ans, dans le secteur public et dans quelques professions prévoyantes.
Tous les mois, 4,5 millions de fonctionnaires capitalisent collectivement au sein de l’ERAFP, un fonds de pension paritaire géré par les syndicats et les employeurs de la fonction publique. Cela leur permet de se constituer un complément de retraite, qui s’ajoute à leur retraite de base et aux compléments de retraite que certains constituent à titre individuel (Préfon ou autres PER individuels…). De même, tous les pharmaciens bénéficient de retraites complémentaires conjuguant répartition et capitalisation.
C’est exactement ce qu’il faut généraliser dans le secteur privé. Les simulations faites lors du conclave montrent que pour les jeunes générations, travailler une heure de plus par semaine pour alimenter une capitalisation collective permettrait d’augmenter le taux de remplacement à la retraite de 17 %. Au lieu de baisser, le pouvoir d’achat des retraités serait préservé sans que cela ne pèse sur les générations futures. En complément, il faut provisionner le régime des retraites des fonctionnaires pour éviter qu’il ne pèse sur les finances publiques et les contribuables.
La capitalisation, justement, est dans le débat national : Jean-Pierre Farandou, le nouveau ministre du Travail a abordé le sujet sans tabou.
Je mettrai cette affirmation au passé. Pendant trop longtemps, la capitalisation a été une pomme de discorde, mais ce temps est révolu depuis qu’en 2003 François Fillon a rendu la capitalisation obligatoire dans la fonction publique avec l’ERAFP.
Comment refuser la généralisation de la capitalisation dans le secteur privé, alors qu’elle est un succès, depuis 20 ans avec 48 milliards de capitaux placés, dans le secteur public ? Comment légitimer une France à deux vitesses, où seuls les fonctionnaires et une partie du secteur privé capitalisent, tandis que la grande masse des salariés serait condamnée à une érosion continuelle de son pouvoir d’achat à la retraite ?
Au début des années 2000, avant que les effets du retournement démographique ne soient intégrés, la capitalisation faisait office de repoussoir. Maintenant, alors qu’il est clair que la répartition est à la peine, il apparaît que généraliser la capitalisation est un impératif social.