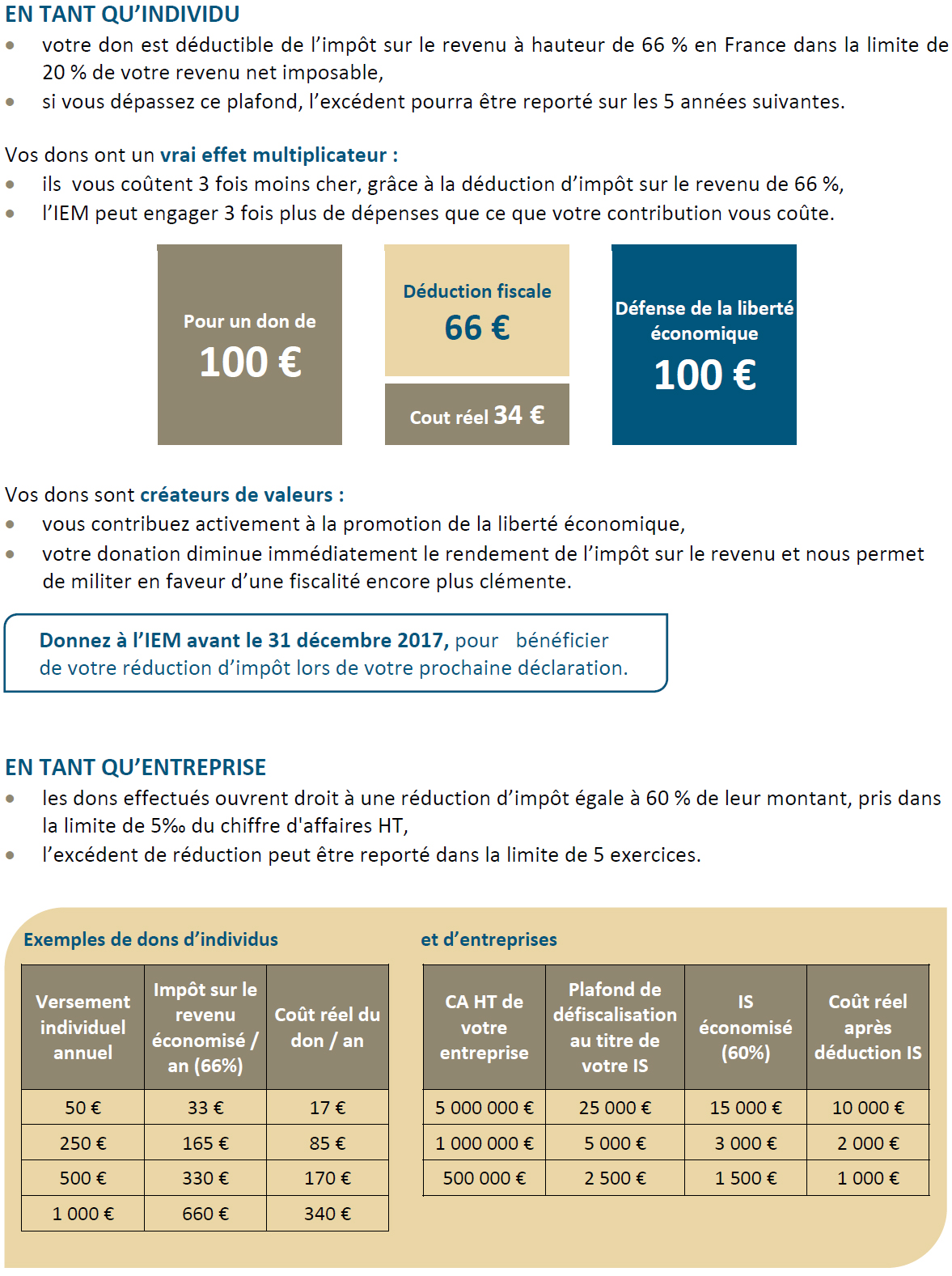Augmenter la pression fiscale, c’est amplifier les problèmes
Nicolas Marques, directeur général de l’Institut économique Molinari, se penche sur la feuille de route des réformes budgétaires annoncées et répond aux questions d’Eric Revel. Une interview publiée dans le Valeurs actuelles du 7 au 13 mai.
Eric Revel. Bercy cherche désespérément 40 milliards d’euros d’économies. Quelles sont les actions les plus efficaces à mener ?
Nicolas Marques. La priorité, c’est de faire de vraies réformes structurelles pour engranger des économies réelles. L’enjeu doit être la remise en ordre des finances publiques avec comme objectif l’équilibrage des comptes en période normale. C’est une démarche qui prendra du temps, mais il faut l’assumer et l’organiser. À force de tourner le dos au temps long, la France a été incapable d’équilibrer ses comptes publics depuis la fin du baby-boom. Elle est ainsi devenue championne de l’endettement. Fin 2024, la dette publique avoisinait les 50 000 euros par personne vivant en France. C’est 8 fois plus qu’à la fin des années 1970 en valeur réelle, lorsqu’on neutralise l’inflation.
La priorité reste la question du financement des retraites qui représentent un quart des dépenses publiques, 45 % de la hausse des dépenses publiques depuis la fin du baby-boom. Première réforme structurelle à faire, confier l’intégralité des retraites du privé aux partenaires sociaux. Ils savent gérer de façon responsable, comme l’illustre leur cogestion des retraites complémentaires par l’Agirc-Arrco depuis 1947. Seconde réforme, provisionner les retraites des fonctionnaires, gérées en dehors de la répartition. Chaque année, l’État verse 60 milliards de pensions à d’anciens personnels, dépense financée pour partie par nos impôts et pour partie par de la dette. L’enjeu est que l’État provisionne cette dépense dans un fonds souverain pour autofinancer les pensions qu’il distribue par les gains générés par l’épargne, comme le font la Banque de France ou le Sénat, sans faire appel au contribuable. Nos travaux montrent que cette opération, même financée par endettement, entraînerait des économies massives. Précisons que l’État dispose déjà de tous les outils avec un Fonds de réserve pour les retraites (FRR) qu’il devrait réalimenter, à l’image alimenter, à l’image de ce que fait l’Espagne.
Lever de nouveaux impôts dans un pays déjà champion du monde de la catégorie pourra-t-il être évité ? Le ministre de l’Aménagement du territoire, François Rebsamen, a parlé « d’une modeste contribution ». Pas de hausses d’impôt, a rappelé Éric Lombard, ministre des Finances !
Augmenter la pression fiscale serait une erreur. La fiscalité est trop forte en France, ce qui pénalise la compétitivité, le pouvoir d’achat et la croissance. Augmenter la pression fiscale, c’est amplifier les problèmes au lieu de les résoudre. Pour réduire le déficit, en attendant que des réformes structurelles produisent leurs effets, la seule piste raisonnable est l’action sur les dépenses.
Que pensez de la méthode « BBZ », budget base zéro, qui obligerait chaque administration à « repenser » chaque dépense, plutôt que de reconduire un budget à l’identique ? Cette méthode employée dans l’entreprise peut-elle fonctionner pour le train de vie de l’État ?
Elle est déjà employée par certaines collectivités locales, par exemple dans le département de la Seine-Maritime, en Normandie, avec des résultats intéressants selon leurs exécutifs. Mais ce n’est pas une recette magique. En Belgique francophone, le BBZ a généré des économies limitées (2 % des dépenses de la Wallonie), réinvesties dans d’autres politiques publiques. Pour que le budget base zéro produise des économies, il faut une forte implication du sommet de l’État à la base, qu’on accepte de poser les vraies questions, en particulier celle du périmètre de l’action publique. Il faut aussi une vraie « fongibilité » des moyens entre administrations pour réallouer les personnels et les budgets là où ils seront les plus utiles.
Notre système compte 467 niches fiscales, ce qui réduit chaque année de 25 % le rendement de l’impôt. Bercy veut en supprimer une cinquantaine. Est-ce réalisable ?
La multiplication des aménagements visant à réduire la dureté de l’impôt est le symptôme d’un mal de fond : la surfiscalité française. Prétendre réduire les niches fiscales sans traiter ce problème relève du déni. C’est parce que nous fiscalisons trop que nous avons autant de niches. Et prétendre, comme l’administration, que les niches fiscales réduisent de 25 % le rendement de l’impôt n’a aucun sens. Les niches engendreraient ce manque à gagner si les acteurs économiques étaient capables de supporter l’impôt à taux plein et ne changeaient pas leurs comportements avec l’augmentation de la pression fiscale consécutive au démantèlement des niches, ce qui est improbable. Nos entreprises sont pénalisées par la surfiscalité française avec notamment des impôts de production qui les poussent hors de France.
Pour limiter cet effet pervers, l’État a développé des crédits d’impôt pour restaurer la compétitivité des entreprises, notamment celles qui font de la recherche (coût estimé à 8 milliards par an). Mais si vous supprimez ces aménagements, l’activité se contractera avec des rentrées fiscales moindres. La même logique vaut pour nombre d’aménagements fiscaux dont profitent les ménages. Si vous supprimez le crédit d’impôt aux particuliers employeurs, l’emploi à domicile chutera ou le travail au noir se développera. Les finances publiques n’en sortiront pas renforcées, loin de là.
Faire contribuer les retraités à l’effort national en supprimant l’abattement fiscal de 10 % sur les pensions : quelles en seraient les conséquences en termes d’économies ?
Mettre à contribution les retraités est une solution de facilité qui ne résout ni les problèmes actuels ni ceux à venir. Les retraites génèrent des déficits parce que nous essayons de les financer intégralement par des prélèvements obligatoires, selon une logique de répartition. Cette façon de faire ne permet pas de financer des retraites généreuses quand le nombre d’actifs par retraité décline. Si nous étions un pays normal, nous aurions une épargne retraite présentant 90 % du PIB pour épauler à la répartition, ce qui produirait une centaine de milliards d’euros par an de dividendes et plus-values. Cela faciliterait le financement des retraites. Nos finances publiques seraient moins déséquilibrées et le gouvernement passerait moins de temps à chercher à augmenter la fiscalité.
Ajoutons que laisser croire que les retraités ne sont pas déjà mis à contribution n’est pas fondé sur les faits, leur pouvoir d’achat est déjà en train de baisser avec le durcissement des règles de calcul des pensions mises en place depuis la fin des années 1990. Pour toutes ces raisons, l’enjeu est de compléter la répartition en généralisant la capitalisation collective, en créant un grand fonds de pension dans le secteur privé sur le modèle de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Au lieu de penser à taxer plus, il faut traiter la priorité, augmenter la création de richesse collective.
L’Italie de Giorgia Meloni affiche des finances publiques assainies. L’Espagne a réduit son déficit public à 2,8 %. Le Portugal dégage des excédents budgétaires. Sommes-nous devenus les « cancres » de l’Europe ?
NM : L’Italie a réussi à baisser ses dépenses publiques de 7,2 % du PIB en 2023 à 3,4 % en 2024 grâce à la réduction drastique de mécanismes de crédit d’impôt mal calibrés mis en place en 2020 et à la bonne tenue de son marché du travail. L’Espagne a atteint une croissance de 3,2 % l’an passé, tandis que le Portugal et la Grèce étaient en excédent. Tous ces pays ont en commun d’avoir fait des ajustements budgétaires très significatifs après la crise de 2008. Ces cigales sont devenues des fourmis, même si la dette publique reste problématique en Grèce et en Italie, à 154 et 135 % du PIB.
Espérons que nous serons capables de redresser nos comptes, comme eux, mais sans subir les turpitudes qu’ils ont vécues lors de la crise de 2008 et les années d’ajustement qui l’ont suivie. Il y a urgence ; avec un déficit représentant 5,8 % du PIB l’an passé, nous étions dans le trio de tête des pays les plus déséquilibrés, derrière la Pologne et la Roumanie, mais ces deux pays ont l’avantage d’avoir des dettes publiques deux fois moins élevées que chez nous (55 % contre 113 %).