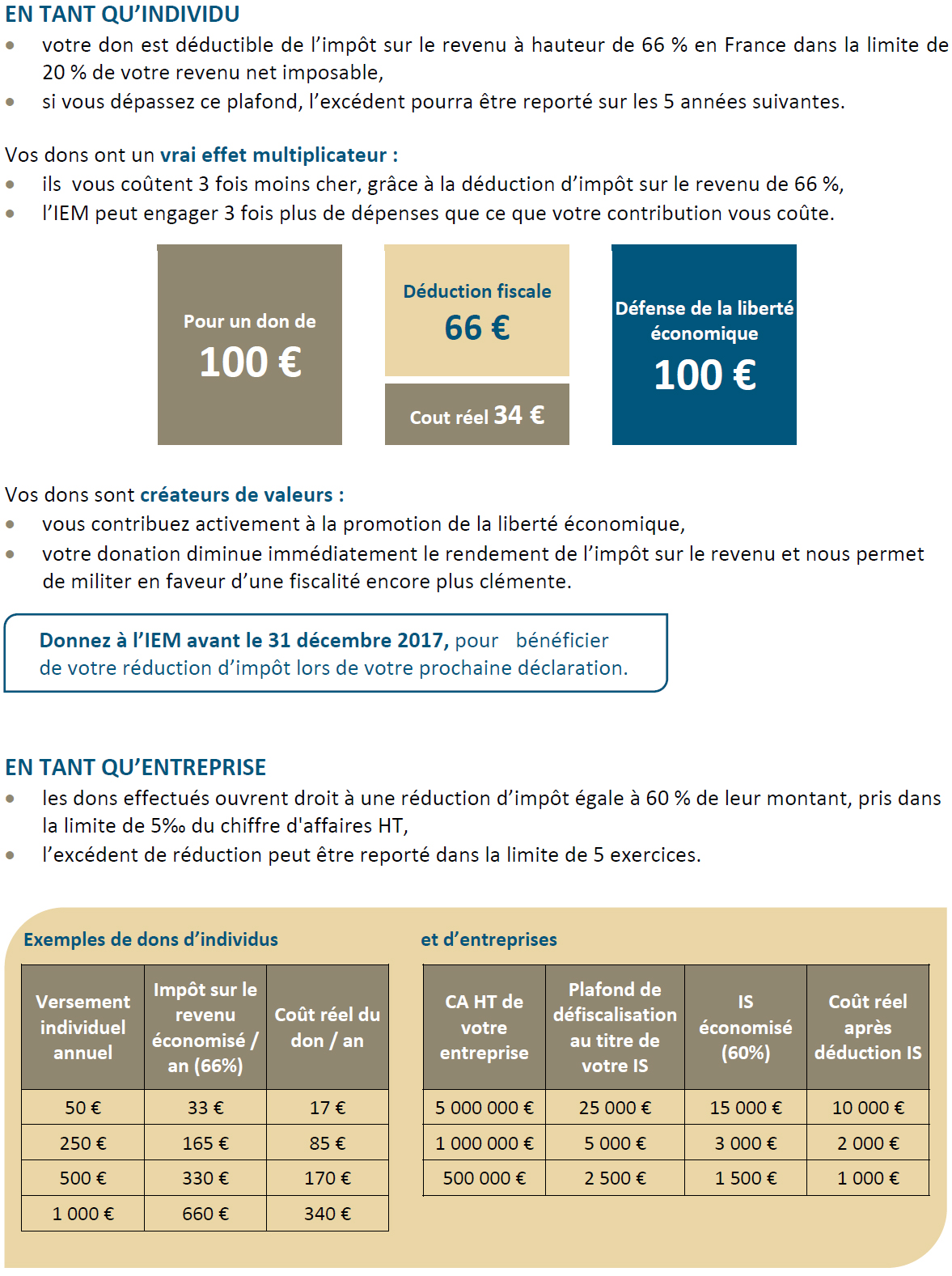La source identifiée d’insolvabilité chronique
Texte d’opinion publié le 14 octobre 2014 dans l’AGEFI.
Dans «Trop tard pour la France?» (Manitoba/les Belles Lettres), l’économiste Cécile Philippe se confronte à la question de la place de l’État dans la société française. Elle rappelle que, depuis les années 1980, le poids des dépenses publiques est devenu supérieur à la moitié de la richesse produite en France. Les Français sont confrontés à un fardeau fiscal et social de plus en plus lourd et à un endettement public sans précédent. La crise que traverse actuellement le pays n’est donc pas seulement financière ou économique, elle a aussi des conséquences humaines et morales bien réelles. Cette période offre pourtant l’opportunité de repenser le rôle de l’État. Pour Cécile Philippe, les pouvoirs publics doivent en faire moins pour laisser le peuple en faire plus.
La dette en soi n’est pas un problème. La difficulté vient de ce que le système monétaire en a fait le fondement de la monnaie. Alors que la monnaie était encore au cours du XXe siècle partiellement couverte par de l’or, elle est depuis 1971 couverte exclusivement par des dettes, ou leur contrepartie des crédits, si on souhaite voir les choses sous un jour plus positif.
Le système de crédit est, quand il n’est pas dénaturé, très utile pour répondre à un besoin fondamental de l’être humain. Il permet de transformer au cours de sa vie ses revenus, son salaire notamment, en richesse, c’est-à-dire en capital qui produit des intérêts. Puis, quand sonne l’heure de la retraite il permet de changer cette richesse en revenus mensuels. Dans la mesure où les individus vieillissent et savent qu’ils ne pourront sans doute pas travailler jusqu’à leur dernière heure, il est crucial pour eux d’avoir un moyen de conserver les revenus qu’ils acquièrent et de les transformer ainsi en richesse qui fructifie au cours du temps grâce au taux d’intérêt qu’il est possible de toucher sur le marché du crédit.
Pour que cette opération se fasse le mieux possible, il est évidemment nécessaire de pouvoir se fier à un système à même de gérer le risque de pertes et non de le multiplier. Or, le système monétaire dont nous avons hérité, déclenche des crises et de longues périodes de récession qui rendent cet objectif difficilement atteignable.
Le système monétaire comprend l’ensemble des règles et des institutions qui encadrent la monnaie utilisée sur un espace géographique donné.
Aujourd’hui, il existe plusieurs systèmes monétaires en concurrence. Les principaux sont le Système monétaire européen (SME), le système qui régit le dollar et celui qui régit le yen. Nos monnaies sont gérées au sein de systèmes hiérarchiques au sommet desquels on trouve une banque centrale: la Fed aux États-Unis (fondée en 1913), la Banque centrale européenne (BCE fondée en 1998) pour les 18 pays de la zone euro, la banque du Japon, etc.
Dans nos systèmes actuels, il y a deux sources de création monétaire. La première est celle que contrôlent les banques centrales, la monnaie «de base». La seconde est celle qu’émettent les banques commerciales, la monnaie scripturale. Les banques ne se contentent pas d’être des intermédiaires entre des épargnants ou des emprunteurs ou de conserver nos dépôts. Elles créent des dépôts en octroyant des crédits. Ce faisant, elles sont in fine les principaux acteurs de la création monétaire.
L’expression «les crédits font les dépôts», connue de tous les étudiants en économie, résume bien la chose. Elle signifie que les banques ont les moyens de créer de la monnaie à l’occasion de la distribution d’un crédit. J’avoue avoir mis du temps à bien saisir cette expression tant elle semble abstraite. Et d’une certaine façon, elle l’est, en particulier dans des systèmes monétaires comme les nôtres où la référence à une monnaie marchandise comme l’or ou l’argent a disparu. Pour expliquer ce phénomène, il faut comprendre que lorsqu’un échange a lieu deux choses sont forcément échangées. Dans le cas d’un crédit octroyé sans épargne préalable, voilà ce qui s’échange: la banque émet des euros en faveur d’un emprunteur en échange d’une créance sur cet emprunteur qui devra au terme du contrat trouver les moyens de rembourser le prêt. Ces moyens lui sont en principe donnés par le prêt de la banque. Mis au service d’un projet réussi, il donnera justement à l’emprunteur cette capacité de remboursement. Ainsi, on a, d’un côté, des euros émis pour un projet et, de l’autre, le projet en cours de réalisation qui, on l’espère, générera suffisamment de ressources pour assurer le remboursement du prêt. Sur le plan comptable, la banque inscrit une dette à l’égard de l’emprunteur à son passif et une créance du même montant à son actif. Les euros disparaîtront si le prêt est remboursé et quand il le sera.
Le processus ne s’arrête cependant pas là. Les dépôts émis en échange d’un crédit initial vont justement servir à développer des projets et à payer des salaires ou des biens et services. Ils vont donc atterrir sur les comptes bancaires des salariés et des fournisseurs. Ils vont alors pouvoir servir de base à l’octroi de nouveaux crédits. Là est aussi le sens de l’expression «les crédits font les dépôts».
On peut ainsi calculer que, si les dépôts d’une banque augmentent d’un montant de 1 million euros et qu’elle respecte un coefficient de réserve de 10%, pas loin de 10 millions d’euros vont pouvoir être créés sous la forme de crédits.
Ce chiffre illustre ce qu’on appelle le multiplicateur monétaire. Il conceptualise l’idée que les banques ne se contentent pas seulement d’allouer l’épargne mise à disposition par leurs clients à des emprunteurs. Une grande partie de leur activité consiste à développer des crédits, sans qu’aucune épargne préalable n’ait été accumulée. Ces crédits vont à leur tour faire naître des dépôts qui susciteront, à leur tour, de nouveaux crédits.
Ce système de banque est dit à réserves «fractionnaires», car seule une partie des dépôts est conservée pour faire face aux demandes de retrait. Comme la création des crédits a un coût pratiquement nul, cela ne constitue pas un frein à leur expansion. Des pyramides de crédits – ou de dettes – peuvent apparaître, des masses de liquidités circulant sur le marché et finançant toutes sortes de projets plus ou moins risqués. Les banques sont des entreprises d’un type particulier. Elles évoluent dans un contexte institutionnel spécifique puisque leur politique de crédit dépend pour partie des actions de la banque centrale dont elles dépendent. En multipliant les dépôts à partir de nouveaux crédits qu’elles ont ouverts – comme le leur permet le système – elles multiplient aussi leurs obligations envers un nombre croissant de déposants. Les banques deviennent de plus en plus tributaires de la capacité des emprunteurs à rembourser leurs crédits.
Lorsque survient un ralentissement de l’économie, la question se pose de savoir s’il s’agit d’un phénomène temporaire ou structurel. Dans le premier cas, les emprunteurs pourront rembourser leurs prêts, mais cela prendra plus de temps que prévu. Dans le second cas, les emprunteurs ne pourront jamais honorer leur dette. Les banques vont alors essuyer des pertes et risquent d’être en situation d’insolvabilité. Une grande partie des débats a tourné autour de la façon de fournir suffisamment de liquidités au système économique et bancaire. Il fallait donner les moyens au système de continuer à fonctionner et notamment permettre aux banques de distribuer les crédits supposés assurer la croissance de nos économies. Le projet d’union bancaire a, quant à lui, pour objectif de trouver une solution à la faillite des banques. Reste qu’elle n’est pas une solution au vrai problème, à savoir l’absence d’incitations de fonds conduisant à une gestion pérenne de l’offre de crédit et de la création monétaire qui en découle.
Cette notion de liquidité est très importante dans le secteur bancaire. Elle représente la capacité d’une banque à remplir ses obligations contractuelles. Elle caractérise son aptitude à ajuster ses engagements à ses flux de revenus. Si une banque gère mal sa liquidité, elle peut être contrainte à la liquidation d’une partie de ses actifs, souvent à des prix sacrifiés.
La liquidité a été décrite par Melchior Palyi. Il explique que le principal risque pour une banque est de ne pas savoir limiter les crédits à des opérations de court terme de type commercial. Il donne ainsi l’exemple d’un marchand américain qui vend pour 100.000 dollars de coton à une filature située en Angleterre. L’acheteur promet de payer à réception de la marchandise. Son crédit est garanti par une banque à qui il signe donc une reconnaissance de dette que l’on appelle «effet de commerce». Or le marchand a besoin de liquidités immédiatement. Il emprunte alors auprès de sa banque américaine en escomptant son effet de commerce pour 75.000 dollars. Il pourra faire des paiements à hauteur de ce montant grâce au crédit porté sur son compte bancaire.
Il apparaît ainsi dans cet exemple que 75.000 dollars ont été créés. Palyi explique que ce type de crédit est auto-liquidateur. Le remboursement sur 90 jours, selon les usages du commerce, est assuré ce qui permettra la liquidation du dépôt émis. Ce crédit est «liquide», car il est né d’une transaction où les dollars créés sont garantis par la vente de nouveaux produits déjà finis. La banque n’a pas favorisé de nouveau pouvoir d’achat. Le coton vendu est le pouvoir d’achat réel qui n’était pas immédiatement accessible au vendeur. La banque s’est contentée de monétiser à l’avance un droit commercial. Elle a fourni temporairement l’argent qui, de toute façon, arrivait rapidement. C’est le rôle du banquier que d’assurer la liquidité de sa banque et donc d’éviter une prise de risques trop grande, sinon gare à la faillite. La banque doit être convaincue qu’il existe bien une transaction saine pour laquelle il y a un acheteur et une banque garante. Bref, elle exerce toutes sortes de contrôles qualitatifs visant à s’assurer de la qualité du crédit en question, c’est-à-dire de sa liquidité. De plus le banquier prendra soin de limiter ses risques. Il ne créditera que partiellement son emprunteur, qui reçoit 75 % de la valeur de sa vente dans l’exemple ci-dessus.
Ajoutons que le banquier dispose de toutes sortes d’indicateurs, comme le ratio des dettes sur fonds propres ou celui des dettes sur l’actif. Proche de ses clients, il peut examiner précisément leur profil de risque, leur historique, exiger des garanties et offrir des crédits en fonction. C’est en cela d’ailleurs que le métier de banquier est à l’origine entrepreneurial.
Il s’en est éloigné, car la description ci-dessous n’est pas celle du système actuel, mais plutôt du système vers lequel il faudrait tendre, avec des institutions rendant les acteurs responsables de leurs actes et les laissant faire faillite.
Le sauvetage des banques a permis, au contraire, que les banques se libérèrent d’une gestion prudente de leur liquidité. Elles peuvent multiplier les opérations sans s’inquiéter de leur solvabilité, ce qui in fine fait courir un risque systémique.
Ce comportement – qui serait irrationnel pour tout acteur économique responsable de ses pertes – ne l’est pas nécessairement pour les banques qui bénéficient avec les banques centrales d’un prêteur en dernier ressort. Ce rôle entraîne un aléa moral, car les banques, se sachant «couvertes», peuvent prendre plus de risques que s’il leur fallait assumer leurs pertes sur leurs seuls fonds propres.
Cet aléa est renforcé par le fait que dans la plupart des pays développés les dépôts sont garantis par l’État. La garantie étatique des dépôts élimine – tant que la signature de l’État reste crédible – les risques de panique bancaire. Cela endort aussi la vigilance des particuliers qui peuvent être moins attentifs à la réputation et aux comportements à risques de leur banque. Introduite aux États-Unis en 1934, l’assurance des dépôts portait initialement sur 5000 dollars. Le montant fut ensuite progressivement augmenté pour atteindre 250.000 dollars aujourd’hui. En France, la garantie s’élève à 100.000 euros. La prise de risques rendue possible par le contexte institutionnel actuel a permis une politique de crédit laxiste. Celle-ci a conduit à un endettement excessif qui a débouché sur la crise actuelle. Face à cette crise, la réponse des pouvoirs publics et des banques centrales a été de jouer les «sauveurs». Or, la question se pose de savoir si cela donne lieu à un assainissement du système et à une responsabilisation des acteurs.
Cécile Philippe détient un doctorat ès sciences économiques de l’Université
Paris-IX Dauphine et d’un Desup en gestion des entreprises dans les
pays en développement. Elle a terminé sa thèse portant sur les théories de
l’information et l’émergence d’un marché de l’information sur Internet
au sein d’un think tank américain. De retour en Europe, elle a crée en 2003
l’Institut économique Molinari, dont elle assure depuis la direction. Elle
est l’auteur d’un grand nombre d’articles publiés dans
des journaux aussi bien francophones qu’anglophones
et de «C’est trop tard pour la terre» (Lattès) en 2007.