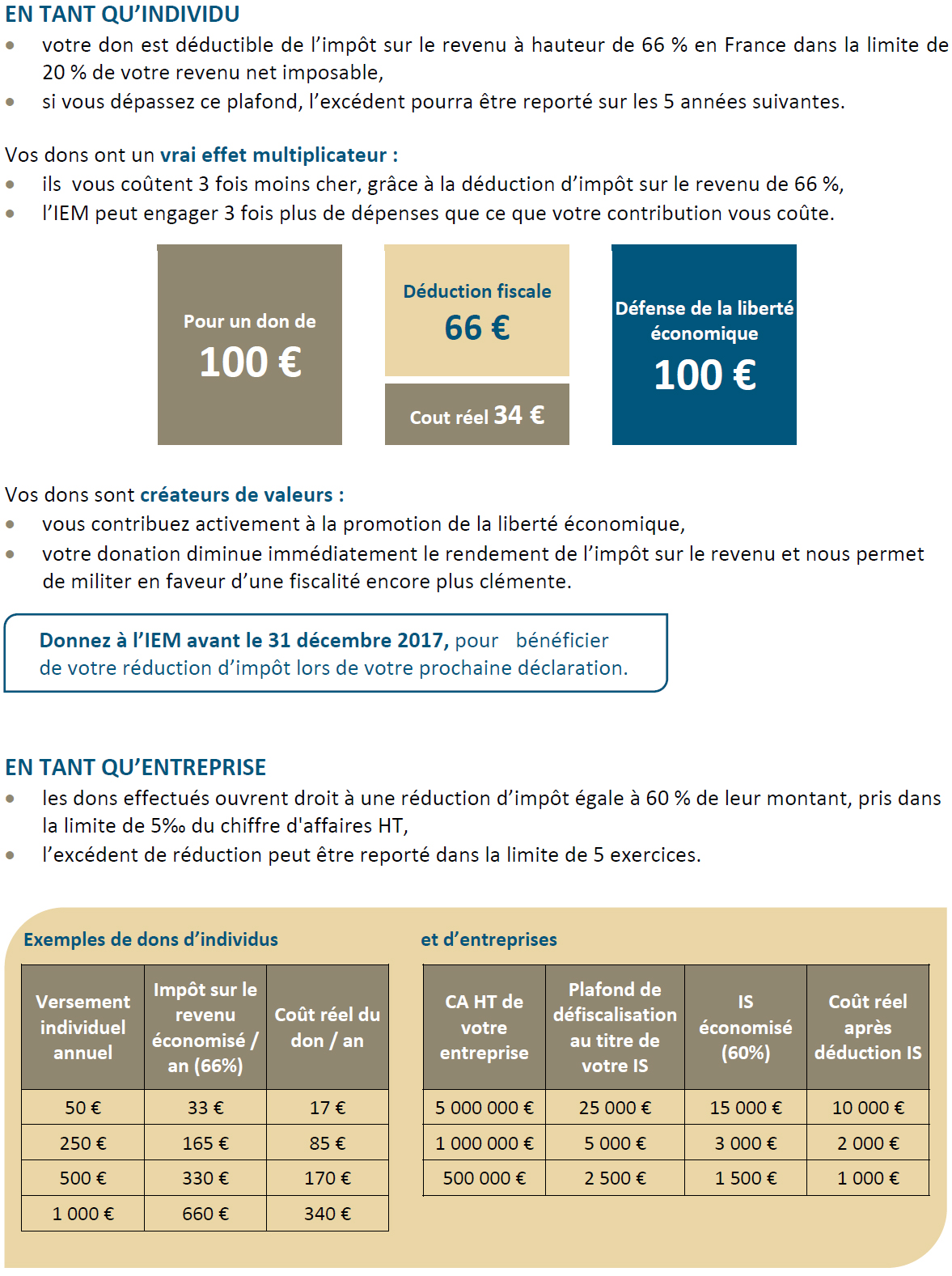Augmenter les impôts, finalement plus efficace que baisser les dépenses : que faut-il penser de cette dernière «découverte» du FMI ?
Interview publiée le 11 septembre 2013 dans Atlantico.
Atlantico : Dans le Social Europe Journal, l’économiste Ronald Janssen, spécialiste des politiques européennes, note, en se basant sur une étude du FMI, que lorsque l’économie est en phase de récession «la réduction des dépenses publiques […] peut faire chuter l’activité globale du PIB sept fois plus qu’une consolidation fiscale» (comprendre des hausses d’impôts). Que penser de cette étude ? Mieux vaut-il finalement augmenter les impôts que de tailler dans les dépenses pour rééquilibrer les comptes publics tout en essayant de sortir une économie de la crise ?
Cécile Philippe : Il faut noter que cette étude du FMI reste relativement isolée. En effet, de nombreuses recherches empiriques, réalisées sur un large échantillon de pays et sur des périodes longues, montrent au contraire une relation négative entre poids excessif de l’État et prospérité. Deux chercheurs français, François Facchini et Mickaël Melki, ont récemment recensé 60 études portant sur cette question. Ils montrent que 66,6% d’entre elles concluent à un impact négatif de la taille de l’État sur la croissance économique. Seuls 8,3% de ces travaux concluent à l’inverse à un impact positif, le reste n’offrant pas de résultat concluant.
Ensuite, nous constatons (données Eurostat) au sein de l’Union européenne dans son ensemble que si les dépenses publiques en pourcentage du PIB ont très légèrement baissé pendant la période 2009-2012, de 1,7 point de pourcentage, la proportion pour 2012 est par ailleurs toujours supérieure de quatre points à celle qui prévalait avant le début de la crise, soit 49,4 % contre 45,6 % en 2007. Plus encore, les dépenses des gouvernements n’ont en fait jamais cessé de croître pour l’UE dans son ensemble depuis le début de la crise financière, sauf en 2011 où elles sont restées constantes. Elles ont crû de 6,3 % pendant les trois dernières années, c’est-à-dire durant la période où des politiques d’«austérité» sont censées avoir été mises en œuvre.
Les seuls pays où les dépenses nominales ont véritablement diminué entre 2009 et 2012 sont la Grèce et le Portugal (c’est aussi le cas de quelques autres pays comme l’Irlande, la Bulgarie, la Roumanie, la Lituanie et la Slovénie). Il faut cependant noter qu’autant en termes nominaux qu’en proportion du PIB, les gouvernements de ces deux pays ont dépensé davantage en 2012 qu’en 2007. Les données d’Eurostat montrent qu’il y a eu une augmentation des recettes fiscales de 12,9 % de 2009 à 2012, soit le double du rythme d’augmentation des dépenses publiques sans que cela nous aide pour autant à sortir de la crise ni à résorber de façon durable les déficits.
Nicolas Goetzmann : L’étude du FMI est formelle sur ce point, le choix de la hausse d’impôts affecte moins le PIB que la réduction des dépenses dans une économie en récession. L’étude a été menée sur plusieurs pays, partout dans le monde, et les résultats sont assez clairs.
Deux points peuvent cependant être soulevés. Le premier est de considérer que cette étude nous livre un résultat sur deux ans, qui peut être qualifié de court terme. Les expériences grecques, portugaises et espagnoles montrent bien que des politiques de baisse sèche des dépenses ont des effets récessionnistes forts. Ce n’est pas une surprise. Ce type de politique équivaut à une opération chirurgicale sans anesthésie.
Ronald Janssen avoue cependant que les effets à long terme sont inversés. L’impact sur le chômage structurel et sur le taux de participation de la population active n’est ici pas neutre. Le second point, le plus malheureux, est de considérer que la hausse des impôts et la baisse des dépenses comme étant les seules alternatives possibles pour contrer une récession. Alors que ces choix-là ne peuvent être que des mesures d’accompagnement d’une réelle politique ambitieuse, c’est-à-dire de mettre en place une politique qui mêle le budgétaire et le monétaire.
Augmenter les impôts plutôt que de réduire les dépenses… Ce choix est-il le même selon que l’on raisonne à court, moyen ou long terme ? Faut-il croire que la «stratégie» menée jusque là par François Hollande était la bonne ?
Nicolas Goetzmann : Bien sûr que non. Nous pouvons dire par contre que la politique de François Hollande n’est pas la pire à court terme, mais celle juste avant. Par contre, elle est la pire sur le long terme. Encore une fois la politique budgétaire et fiscale est secondaire ici, elle doit être utilisée en complément d’une politique monétaire adéquate pour avoir des effets bénéfiques.
La politique la plus efficace pour contrer la récession est de soutenir l’économie par la voie monétaire pour rétablir la croissance et l’emploi, et de mener une politique de baisse des dépenses publiques au même moment. C’est ainsi que la France pourrait rétablir un ratio de dépense publique sur PIB un peu plus décent (56% aujourd’hui . Il suffirait d’ailleurs de stabiliser la dépense publique tout en bénéficiant d’une croissance soutenue pour faire baisser ce ratio. Mais nous avons choisi une politique qui en réalité n’a pas de sens. Il n’y a rien à en espérer sur le long terme.
Cécile Philippe : C’est très exactement la question qu’il faut se poser. L’exemple du Canada dans les années 1990 montre que de légères hausses d’impôts dans un premier temps ont ensuite été suivies de baisses d’impôts considérables dès lors que la croissance était repartie sur de bonnes bases. Il n’empêche que ces hausses d’impôts étaient très ciblées et s’intégraient dans une stratégie visant à rendre à la sphère privée sa capacité d’action par des baisses drastiques des dépenses publiques.
Or, la «stratégie» Hollande a principalement consisté à augmenter les impôts, charges et autres taxes. Il avait d’ailleurs en cela été précédé par Nicolas Sarkozy. Or, ce qu’il faut bien comprendre dans le cas de la France – ce qui n’est peut-être pas vrai pour d’autres pays, c’est qu’elle croule déjà sous le poids des impôts, taxes et autres charges. Nous avons ainsi calculé que la France détenait un record en la matière. Aucun autre pays européen ne pratique une fiscalité plus importante et n’a des finances publiques aussi déséquilibrées pour l’an passé.
A côté de cela, on attend toujours de la visibilité sur les possibles baisses de dépenses publiques. Le récent débat sur la réforme des retraites a indiqué qu’elle ne semblait pas encore à l’ordre du jour puisque la principale mesure consistait à augmenter les cotisations patronales et salariales et donc le coût du travail. Il est fort à parier que les Français pourraient accepter des hausses d’impôts s’ils voyaient qu’à terme cela peut permettre au pays de sortir de son marasme et qu’ils pourront ainsi récupérer du pouvoir d’achat. Or, cette vision reste absente à ce jour.
Quelle que soit l’option retenue (hausses d’impôts ou réduction des dépenses), comment compenser les effets récessifs qu’entraîne une telle politique économique ? La politique monétaire – avec une politique expansionniste – peut-elle servir d’outil pour neutraliser ces effets récessifs ?
Nicolas Goetzmann : La politique monétaire guide la politique budgétaire, en effet. La politique budgétaire ne changera pas grand-chose à la «demande» c’est-à-dire à la croissance. La «demande» est la variable sous contrôle de la banque centrale, point. A partir de là, toutes les expériences peuvent être tentées, mais la réalité reste celle-ci.
Si nous n’actionnons pas la Banque centrale pour obtenir un niveau d’activité soutenu, nous ne pourrons nous contenter que de ce genre de comptes de boutiquiers pour savoir quelle est la politique la plus destructrice, tout en criant victoire lorsque la politique choisie n’est pas la pire de toutes. Regardons autour de nous, les États-Unis se servent du monétaire, le Royaume-Uni et le Japon également. Les États-Unis et le Royaume-Uni y mêlent une baisse des dépenses publiques et obtiennent des succès non négligeables. Le Japon va quant à lui sans doute relever son taux de TVA, ce qui est un risque, mais a au moins entrepris de se servir de sa Banque centrale pour en finir avec la crise. La révision du PIB japonais au second trimestre à 3.8% de croissance laisse peu de doute sur l’efficacité de la mesure.
Cécile Philippe : Je crois qu’il ne faut pas vouloir l’impossible. Toute cure d’amaigrissement ou sevrage est difficile. C’est d’ailleurs pourquoi le meilleur des remèdes est la prévention, c’est-à-dire savoir éviter de tomber dans la spirale de l’endettement. Par conséquent, la question principale n’est pas d’éviter tous les effets récessifs – ils sont nécessaires à un assainissement de la situation – mais plutôt de les atténuer dans la durée.
Or, pour ce faire, il existe une arme particulièrement efficace qui est celle de la déréglementation ou comme l’appelle le gouvernement actuel le choc de simplification. Celle-ci doit s’organiser autour de la responsabilité individuelle, en redonnant à chacun plus de liberté d’innover, de prendre des initiatives, etc.
En France, les marges de manœuvre sont énormes, en particulier sur le marché du travail qui en plus d’être hyper fiscalisé, est hyper réglementé. Il est possible de le rendre beaucoup plus souple et flexible en s’attaquant à la réglementation sur la durée légale du travail, le salaire minimum, la liberté de licenciement, etc… Autre grande réforme à faire, celle qui consisterait à désacraliser le principe de précaution. Son application de plus en plus systématique finit par avoir un effet particulièrement dépressif sur l’innovation et le progrès technologique qui sont des stimulants très importants de la croissance.
Cécile Philippe est directrice générale de l’Institut économique Molinari. Nicolas Goetzmann est stratégiste macroéconomique et auteur d’un rapport sur la politique monétaire européenne pour le compte de la Fondapol.