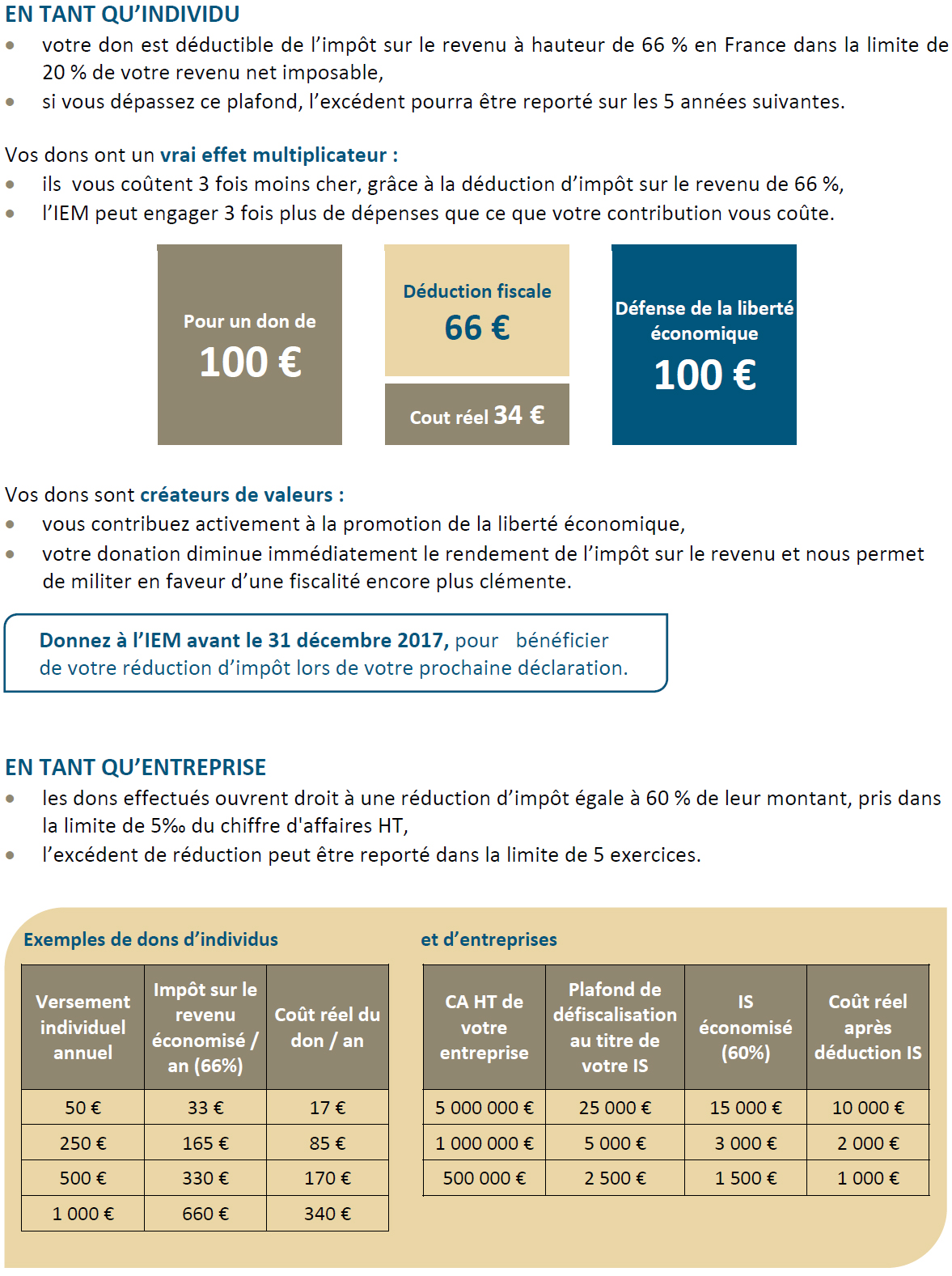Relancer l’économie par la réforme de l’État
Une version écourtée de cet article est parue sur LeMonde.fr.
Depuis plusieurs semaines, on peine à suivre les dizaines, voire les centaines de milliards qui défilent chaque jour à la une des journaux. La relance de l’économie mondiale est-elle à ce prix ? 819 milliards votés aux États-Unis, 26 milliards en France, 50 milliards en Allemagne, etc.
Mais ces plans successifs, quelle que soit leur ampleur, ne permettent pas de résoudre le problème de fond de l’économie : la restructuration nécessaire de nombreuses activités. Plutôt que des dépenses somptuaires, le redémarrage de l’activité économique suppose une baisse conséquente tant des impôts que des dépenses publiques.
Dans le débat public, la relance de la consommation est souvent présentée comme l’enjeu primordial. C’est là se méprendre. L’économie souffre en réalité du trop-plein de crédit dont elle a bénéficié ces dernières années, et d’un gonflement trop important de certaines activités.
Pendant des années, la politique monétaire laxiste des États-Unis a permis à de nombreuses industries d’emprunter massivement et donc de croître. De nombreux investissements ont été rendus artificiellement rentables du fait de la faiblesse des taux d’intérêts. Les secteurs qui ont fortement bénéficié de ces crédits faciles ont alors connu des années fastes. Ils se sont développés et ont embauché. L’immobilier ou l’automobile ont par exemple tiré parti des crédits qui ont été distribués très généreusement aux particuliers par les banques. De leur côté, celles-ci ont été incitées à prêter, notamment du fait de l’existence de sanctions si elles n’émettaient pas suffisamment de crédits. La politique monétaire des États-Unis – suivie, dans de moindres proportions, par la Banque Centrale Européenne – a permis la formation d’une bulle économique.
Mais la richesse générée par des secteurs tels que l’immobilier n’était qu’apparente, fondée sur un afflux de crédits créés sans épargne privée préalable. La remontée progressive des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, passés de 1 à 4,5 % entre 2004 et 2006, a conduit à l’explosion de la bulle. Les activités qui ont le plus bénéficié du crédit depuis 2000 sont les premières à souffrir, car leur rentabilité ne dépend que de cela. L’immobilier, surtout aux États-Unis, connaît de nombreuses faillites. Quand à l’automobile, le secteur croule sous les difficultés : aux États-Unis, les « big three » – General Motors, Chrysler et Ford – sont passées au bord de la faillite. La crise s’est ensuite propagée à l’ensemble de l’économie.
Face à cela, les plans de relance sont d’un effet limité et ont pour contrepartie la fragilisation de très nombreuses entreprises. En effet, ces plans sont financés par l’emprunt et réduisent la quantité d’épargne disponible pour les entreprises. Entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, la dette de l’État américain est passée de 9210 milliards de dollars à 10627 milliards, soit une hausse de 15 %, alors qu’elle avait « seulement » crû de 6 % en 2006 et 2007. Tout ce que les États empruntent sur le marché des capitaux est pris dans la réserve d’épargne que les citoyens cherchent à placer. En empruntant toujours plus, les États capturent une partie de l’épargne, qui ne pourra donc pas aller vers les grandes entreprises, lesquelles cherchent également à se financer par l’émission d’obligations.
Si l’argent des plans de relance n’était pas dépensé par les gouvernements, il resterait à la disposition des entreprises, qui pourraient investir ou embaucher. Tel n’est cependant pas le cas, et les montants astronomiques aujourd’hui empruntés par les États assèchent le marché des capitaux, font monter les taux d’intérêts, et déstabilisent l’ensemble du secteur privé.
Les plans de relance sont donc assimilables à une redistribution qui bénéficie à quelques entreprises au détriment des très nombreuses autres. Plutôt que de permettre le développement des activités d’avenir, ils maintiennent en place des activités non rentables. Ils ralentissent donc un processus nécessaire à la reprise : la restructuration de nombreuses activités.
Toute tentative de hâter la relance est-elle donc vouée à l’échec ? Non, certaines réformes structurelles peuvent accélérer le processus de restructuration. Il faut libérer des ressources réelles à la disposition du secteur privé dans l’économie, ce qui ne peut se faire qu’en réduisant la part du secteur public.
Dans un pays, la richesse créée chaque année par le secteur privé est pour partie conservée par ceux qui l’ont produite, pour partie prélevée et dépensée par l’État. En France, les dépenses publiques représentent par exemple 52,7 % du produit intérieur brut (PIB), contre 43,8 % en Allemagne ou 37,8 % aux États-Unis. Une baisse de ces taux, c’est-à-dire un accroissement de la part du PIB laissée aux individus permettrait de libérer des milliards d’euros dans l’économie. Pour y parvenir, il conviendrait de baisser les prélèvements obligatoires. Ceci générerait des incitations positives à travailler, à entreprendre et à investir. Au final, cela permettrait de stimuler tant la consommation que l’investissement.
Mais les allègements fiscaux ne sauraient se suffire à eux-mêmes, dans la mesure où ils sont aujourd’hui financés par l’endettement sans qu’il n’y ait plus d’épargne ou de ressources réelles dans l’économie. La diminution des taux d’imposition doit nécessairement s’accompagner d’une diminution au moins équivalente des dépenses publiques. Les entreprises seraient ainsi débarrassées d’une partie du fardeau fiscal qui pèse sur leur activité et pourraient diriger les ressources ainsi libérées vers leurs usages les plus productifs.
En période de crise, la tendance naturelle des gouvernements est d’intervenir davantage. Il s’agit pourtant là d’un écueil. Quels que soient les montants engagés, les plans de relance ne permettront pas de transformer une activité non rentable en activité rentable. Au contraire, ils fragilisent les secteurs qui correspondent à une demande réelle. La meilleure forme de relance consiste en la baisse conjointe des taux d’imposition et des dépenses publiques. C’est seulement ainsi que les activités au bord de la faillite pourront se restructurer et que les secteurs porteurs de croissance pourront prospérer.
Guillaume Vuillemey et Vincent Poncet sont chercheurs à l’Institut économique Molinari.