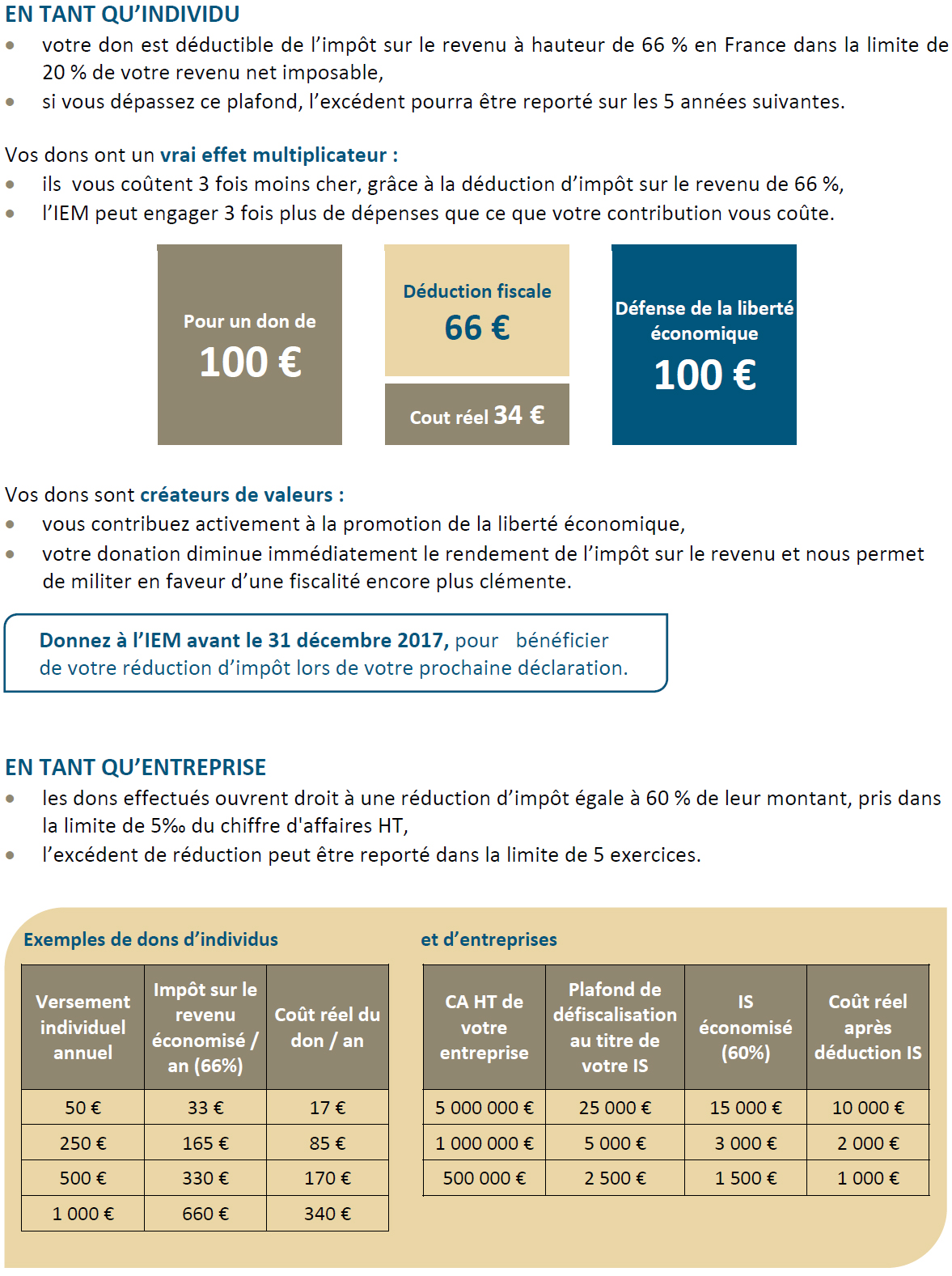Ne pas importer la crise des subprimes en France
Article publié par Les Echos le 13 octobre 2008.
Alors que la tourmente financière n’en finit pas de faire plier le système bancaire, l’on pourrait penser que la priorité actuelle de tout dirigeant politique serait de ne rien décider qui puisse fragiliser les établissements financiers. Nicolas Sarkozy n’a visiblement pas la même analyse de la situation.
Alors que la tourmente financière n’en finit pas de faire plier le système bancaire, l’on pourrait penser que la priorité actuelle de tout dirigeant politique serait de ne rien décider qui puisse fragiliser les établissements financiers.
Nicolas Sarkozy n’a visiblement pas la même analyse de la situation, et propose ni plus ni moins que de développer en France les mécanismes qui ont entraîné le déclenchement de la crise des subprimes outre-Atlantique.
Celle-ci est née parce que le gouvernement américain, faisant passer ses objectifs de politique sociale avant la pérennité économique des institutions financières, a obligé deux entreprises à statut réglementé sous sa tutelle, Fannie Mae et Freddie Mac, à racheter aux banques une proportion croissante, et finalement déraisonnable, de prêts accordés à des familles pauvres. Il les a ensuite autorisées à revendre ces prêts sous forme de produits dérivés complexes bénéficiant d’une garantie de remboursement supportée in fine par l’État fédéral. Une telle prodigalité a encouragé les banques à prêter bien imprudemment des sommes trop élevées à des clients manifestement insolvables. On connaît la suite.
Quotas élevés de prêts à caractère social, garantie publique de créances… Une des mesures annoncées par Nicolas Sarkozy le 1er octobre présente des caractéristiques similaires. Il s’agit du relèvement du plafond de ressources ouvrant droit à la garantie que l’État apporte aux crédits immobiliers des ménages via les « prêts d’accession sociale ». 60 % des ménages contractant un crédit immobilier deviendraient éligibles à cette garantie contre seulement 20 % actuellement.
On le voit aux États-Unis aujourd’hui : lorsque l’État garantit des créanciers contre le risque de faillite de certains débiteurs, il suscite nécessairement une moindre sélectivité dans l’octroi des prêts. En effet, pourquoi ne pas élever son niveau d’exposition au risque pour engranger plus de profits quand la conjoncture est bonne, et faire supporter les pertes par les contribuables lorsque celle ci se retourne ? Ajoutons que la garantie de l’État pousse les investisseurs à ne pas se montrer trop exigeants quant à la lisibilité des produits dérivés que l’ingénierie financière suscite autour de ces crédits: le soutien étatique encourage l’irresponsabilité de toutes les parties prenantes.
Du fait de ce probable relâchement de la vigilance des banques, l’État risque d’avoir à garantir de nombreuses défaillances si un aléa conjoncturel conduit trop d’emprunteurs fragiles à interrompre leurs remboursements. Les banques prêteuses se retourneraient donc vers l’État pour qu’il exerce sa garantie, sous peine de se retrouver elles-mêmes en grande difficulté. Seul problème : notre État, déjà fort endetté et incapable de maîtriser ses déficits, n’a pas les mêmes moyens que le trésor américain pour faire face à des défaillances de grande ampleur. Sa garantie n’est qu’un chèque en blanc sans provisions !
Autre conséquence envisageable, ces engagements inconsidérés risquent de détériorer la réputation de la signature de l’État auprès de tous ceux qui lui prêtent de l’argent. Et que se passerait-il si les agences de notation venaient à dégrader leur cotation de la dette Française ? L’État devrait payer, comme prime de risque, un taux d’intérêt plus élevé à ses créanciers. Son budget verrait alors sa charge d’intérêts d’emprunts et son déficit déraper, la confiance des prêteurs se dégrader encore… Un cercle vicieux qui pourrait à terme menacer sa capacité d’emprunter à des taux raisonnables, le contraignant à se déclarer en faillite !
Ce scénario est il exagérément pessimiste ? Espérons-le, mais il s’est déjà produit en Europe, quand le gouvernement suédois s’est livré à partir de 1990 à une surenchère d’interventions publiques pour combattre la récession qui s’annonçait alors. Ayant des difficultés à emprunter même à des taux d’intérêt très élevés, l’État scandinave pour éviter la banqueroute dût dévaluer sa monnaie nationale en 1992 détériorant le pouvoir d’achat des Suédois. Tout comme la crise des subprimes, cet exemple européen nous montre qu’un État ne peut durablement promettre ou garantir tout et n’importe quoi avec l’argent qu’il n’a pas, sans tôt ou tard faire payer un prix exagérément lourd à ses contribuables.
Pourquoi faire courir de tels risques à notre système financier ? « Pour soutenir la construction », nous dit-on. Mais toutes les politiques d’aide à tel ou tel lobby s’exercent aux dépens des contribuables qui les financent, et des entreprises en dehors du périmètre de la subvention. Ces politiques ne créent pas de richesse, elles ne font que la transférer vers les agents économiques les moins efficaces. L’importation des mécanismes vénéneux qui ont empoisonné la finance américaine n’aura même pas d’effet économique positif à court terme. Il est donc urgent d’y renoncer.
Vincent Bénard est chercheur associé à l’Institut économique Molinari et auteur de Logement, crise publique, remèdes privés (éd. Romillat, 2007).