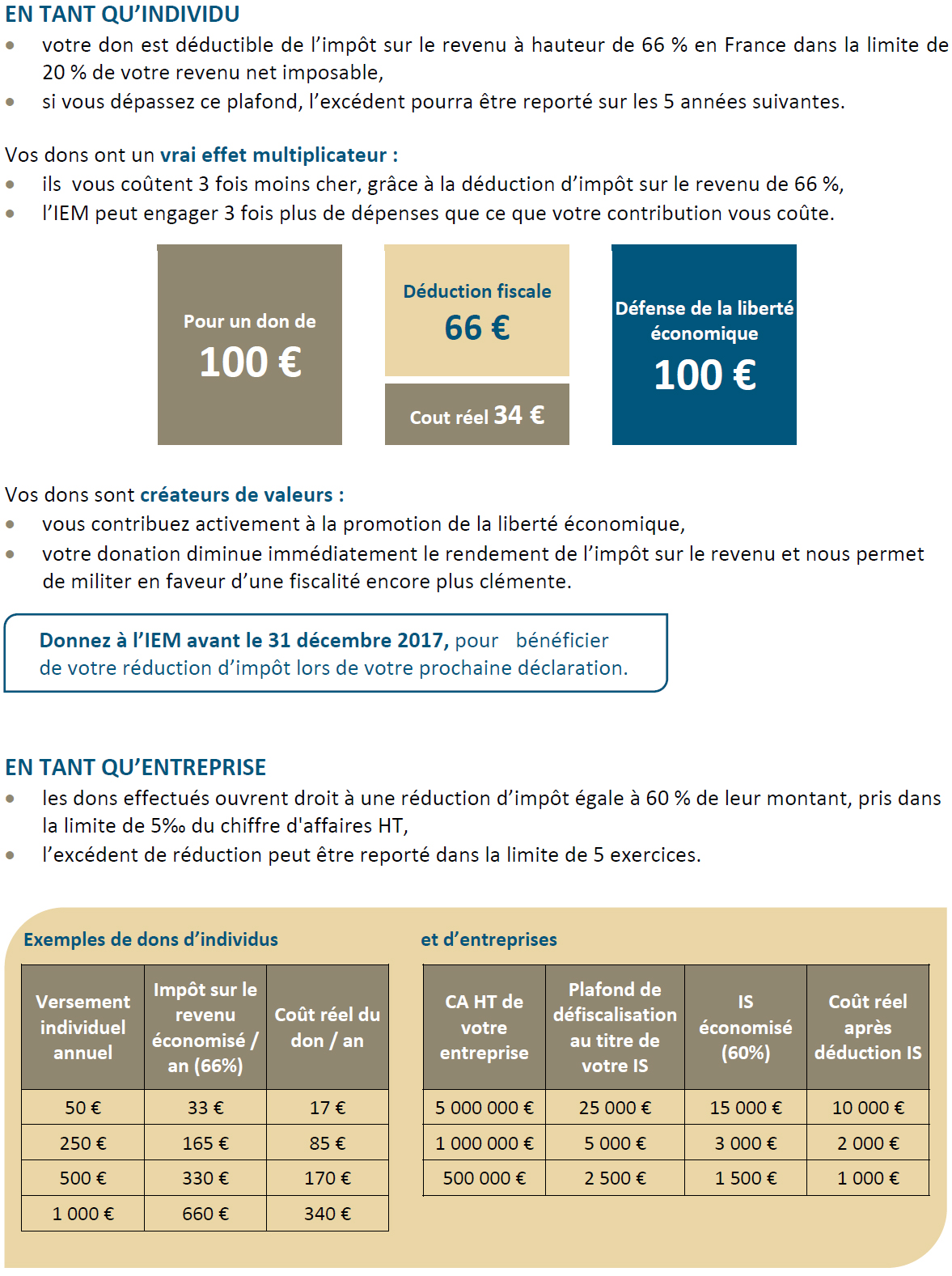L’après-Covid-19 et le défi de l’efficacité fiscale
Une vingtaine de représentants de la société civile et du monde des think tanks viennent de publier Réformer pour Libérer, un recueil destiné à préparer l’après Covid-19. Nous reproduisons ci-dessous les propositions fiscales, rédigées par Victor Fouquet, analyste à l’Institut de recherches économiques et fiscales, et Nicolas Marques, directeur général de l’Institut économique Molinari.
La dégradation de l’économie française et des comptes publics liée au confinement est d’une ampleur vertigineuse. Rappelons que le deuxième budget rectificatif adopté par le Parlement le 23 avril 2020 a été construit à partir d’une prévision de récession évaluée par le Gouvernement à 8 % sur l’ensemble de l’année 2020 (contre 1 % dans la première loi de finances rectificative, un mois plus tôt) et un déficit budgétaire plus que doublé par rapport à la prévision déjà creusée de la loi de finances initiale pour 2020 (183,5 milliards d’euros, contre 93,1 milliards d’euros trois mois et demi plus tôt). D’un point de vue strictement fiscal, une récession de 8 % du PIB provoquerait une baisse des recettes évaluée à 42,7 milliards d’euros. Encore le scénario retenu par l’exécutif suppose-t-il un rebond rapide de la croissance en sortie de confinement qui n’a rien d’évident. La détérioration de l’ensemble de ces prévisions devrait donc se poursuivre au gré des prochains « collectifs budgétaires », à commencer par celui annoncé courant mai. Certains instituts de conjoncture tablent déjà, par exemple, sur une chute du PIB de près de 14 % en 2020.
À terme, la soutenabilité des finances publiques laisse d’autant plus craindre des hausses d’impôts que sont généralement ignorés en France la forte réactivité des agents et les effets de la fiscalité sur l’élasticité du comportement d’activité. Rarement au fait des règles de répercussion fiscale, les décideurs publics perçoivent bien souvent la fiscalité comme un simple système de vases communicants. Or, en frappant les transactions et en freinant les échanges (de biens, de services, ou de facteurs de production), l’impôt exerce sur l’activité économique des effets négatifs – plus ou moins prononcés selon les techniques fiscales usitées – qu’il serait collectivement suicidaire d’ignorer plus longtemps sans risquer de plonger durablement le pays dans l’abîme. Bien qu’il serve de boussole à la politique fiscale française depuis quarante ans, le principe de la capacité contributive fondé sur le pouvoir de contrainte de l’État ne constitue pas la seule approche envisageable. Plébiscité par plusieurs générations de chercheurs en science fiscale, le principe de l’équivalence comme principe de taxation optimale pourrait connaître un regain d’intérêt à la faveur de la pandémie de Covid-19. Dans un contexte d’économie exsangue et de marges de manœuvre limitées, le défi posé aux responsables politiques en quête de ressources sera de réduire autant que possible les dommages infligés à l’économie par la fiscalité. Puisque l’impôt se nourrit de l’économie, un État soucieux de sa richesse future devra en effet veiller à limiter l’impact négatif des prélèvements fiscaux sur l’économie.
Dans le domaine de la fiscalité portant sur les personnes, l’impôt sur le revenu crée des « désincitations » majeures au travail et à l’épargne, tous deux pourtant indispensables à la création de richesse.
En créant des taux marginaux très largement supérieurs aux taux moyens, l’IR accentue l’inefficacité économique de la fiscalité française, avec un rendement faible (seulement 7 % de la masse globale des prélèvements obligatoires en dépit de taux marginaux élevés) compte tenu d’une base étroite car rognée de multiples dispositifs dérogatoires (plus de 180). Des études empiriques (Gruber et Saez, 2000 ; Arnold et al., 2011) ont montré un effet de substitution d’autant plus fort que le taux marginal d’imposition du revenu est élevé. De façon plus générale, le « triangle de Harberger » (1971) a mis en évidence que le coût infligé à l’économie par l’impôt était proportionnel au carré de son taux, tandis que le produit fiscal était moins que proportionnel à ce taux d’imposition. Ces travaux militent pour une baisse significative des taux marginaux de l’impôt sur le revenu, accompagnée éventuellement d’une diminution des dépenses fiscales (en nombre et en volume) génératrices de coûts cachés.
Au-delà du seul IR, la France est pénalisée par l’écart entre le coût et la rémunération du travail. Le « coin fiscal » (tax wedge) est dans notre pays singulièrement élevé, à la fois en termes moyens et en termes marginaux.
Côté fiscalité indirecte, la TVA, qui compte pour près de la moitié dans le budget général de l’État, est pratiquement proportionnelle. Reste que la France est le seul pays de l’Union européenne, avec l’Irlande et l’Italie, à appliquer quatre taux différents de TVA (auxquels il convient encore d’ajouter les taux particuliers applicables à la Corse et aux territoires ultra-marins et divers taux spécifiques). L’effet redistributif nécessairement limité de la TVA rend pourtant vaine la différenciation de ses taux qui, de surcroît, altère le niveau de recettes de cet impôt.
Dans le domaine de la fiscalité présentée comme portant sur les « entreprises », la crise nous met au pied du mur.
Les entreprises, étouffées par une fiscalité hors norme et une réglementation tatillonne, ont des problèmes de compétitivité structurels. Les précédentes crises les ont particulièrement affaiblies, ce qui expliquait la persistance d’un chômage anormalement élevé avant celle du virus Covid-19.
Si le grand public a l’impression que beaucoup a été fait pour favoriser les entreprises dans les dernières années, avec une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés à 25 %, la réalité est bien différente. D’une part, cette baisse de l’impôt sur les sociétés, annoncée en 2017, ne devrait être opérationnelle pour toutes les entreprises qu’à « horizon » 2022. Ensuite, le taux français, même ramené à 25 %, restera significatif. En 2018, la moitié des pays de l’OCDE pratiquait déjà un taux inférieur. Mais surtout, cette baisse, qui ne concerne que la fiscalité sur les bénéfices, occulte le vrai problème français. Dans l’Hexagone, l’essentiel de la fiscalité sur les entreprises n’est pas assis sur les bénéfices. Nous avons la particularité d’avoir une multitude d’impôts sur le foncier (cotisation foncière des entreprises (CFE), taxes sur les bureaux ou les surfaces commerciales, etc.), la masse salariale (taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires, versement transport) et les avantages offerts aux salariés (forfait social, taxes sur les véhicules de sociétés…), le chiffre d’affaires (C3S), la valeur ajoutée (CVAE) ou les dividendes. Ces impôts dit « de production » représentaient plus de 75 milliards d’euros en 2018, soit bien plus que l’impôt sur les sociétés ayant rapporté 27 milliards cette année-là.
Les impôts de production sont problématiques à double titre pour la société française. D’une part, ils sont bien plus nocifs que les fiscalités classiques. Ils ne portent pas sur les bénéfices des entreprises, mais sur des assiettes en amont du résultat et déconnectées de celui-ci. Ces assiettes ne sont pas liées à la performance et capacité contributive des acteurs économiques. Cela rend la fiscalité de production insensible à la situation financière des entreprises et particulièrement nocive. Cette fiscalité, qui s’apparente à une subvention aux importations, lamine la compétitivité de nos acteurs positionnés sur des productions à faible valeur ajoutée. Elle incite aux délocalisations, qu’il s’agisse de produits basiques (tels les masques de protections dont nous manquons…) ou de produits à forte valeur ajoutée. D’autre part, nous abusons de cette fiscalité. En 2018, avec 75 milliards d’impôts de production, nous avions le tiers des impôts de production sur les entreprises de l’UE à 28, alors que nous représentions seulement 15 % de la richesse créée. Les impôts de production sur les entreprises représentaient 3,2 % du PIB, contre 1,6 % dans l’UE et 0,4 % en Allemagne. Bilan : les entreprises françaises souffrent d’un manque de rentabilité par rapport à leurs concurrentes européennes. Leur excédent brut d’exploitation représentait 7,1 % du chiffre d’affaires en 2017, contre 10,1 % en moyenne dans l’UE à 27 pays. Ce différentiel de 30 % et 3 points n’est pas anodin. Il a des conséquences sociales majeures. Conformément à la théorie de l’incidence fiscale, cette fiscalité retombe sur les individus, chômeurs, salariés, consommateurs ou actionnaires.
Les premiers à souffrir de cette fiscalité sont les chômeurs. Les impôts de production incitent à privilégier les investissements à l’étranger et à délaisser l’Hexagone.
Ce n’est pas un hasard si les entreprises du CAC 40 ou nos ETI sont très internationalisées. Au-delà des enjeux de diversification et d’implantation sur les marchés étrangers, elles ont un besoin vital de réduire leur exposition à la sur-fiscalité française. Nombre de PME – et a fortiori de TPE – n’ont pas autant de facilités à s’extraire du cadre franco-français, ce qui explique l’importance des défaillances ou leurs difficultés à grandir. Avant même la crise du coronavirus, en février, le taux de chômage français était encore à 8,1 %, contre 6,5 % dans l’Union européenne et 3,2 % en Allemagne. Nous avions 500 000 chômeurs de trop par rapport à la moyenne européenne et 1 450 000 de trop par rapport à nos voisins d’outre-Rhin. Les salariés, comme les actionnaires, font aussi les frais des impôts de production. Lorsque les entreprises ne sont pas à même de reporter la surfiscalité française sur leurs clients, ce sont eux qui supportent le coût de cette fiscalité, avec des augmentations de salaires ou des rémunérations du capital moindres que ce que l’on observe à l’étranger.
Jusqu’à présent, les pouvoirs publics n’ont pas donné à ce sujet la priorité qu’il mérite et, à ce stade, nous en sommes encore aux promesses. Les pouvoirs publics ont mis en place des groupes de travail (Dubief et Le Pape, 2018), commandé des notes (Martin et Trannoy, 2019), se sont engagés à traiter le sujet, mais ne semblent pas avoir de stratégie claire. Or, la pandémie du coronavirus ne permet plus d’attendre. Pour toute une série de facteurs – absence d’anticipation, difficulté à associer le secteur privé et à déployer des tests, incapacité à moduler le confinement selon les territoires, difficulté à faire émerger des consensus permettant le redémarrage de l’activité économique –, l’économie française est particulièrement affectée. Le dispositif d’accompagnement mis en place par les autorités repose avant tout sur des reports d’échéances, les annulations de charges et d’impôts étant cantonnées à certains secteurs (le Gouvernement s’est engagé sur 750 millions à 1 milliard d’euros d’annulations en faveur de l’hôtellerie, de la restauration et de l’événementiel).
La fiscalité de production, assise sur des assiettes déconnectées des résultats, conjuguée avec la pandémie, est une arme de destruction massive pour notre économie. Elle risque de provoquer une multitude de faillites, mais aussi d’accroître le différentiel de compétitivité avec nos voisins. L’écart sera particulièrement significatif avec l’Allemagne. Elle a en temps normal 8 fois moins d’impôts de production et n’a pas eu besoin de ralentir drastiquement son économie, une politique intensive de dépistage ayant permis de pratiquer un confinement plus sélectif. La clef pour traiter ce sujet est d’offrir une alternative crédible aux collectivités locales, qui bénéficient de l’essentiel des impôts de production. Le démantèlement de ces fiscalités, mortifères pour les économies locales et leurs administrés, représente un défi financier pour les collectivités. Pour autant, les bonnes pratiques étrangères montrent que ce manque à gagner pourrait être compensé par une affectation d’une partie d’autres fiscalités. Elles pourraient, par exemple, bénéficier en contrepartie d’une partie des recettes d’impôts sur les sociétés, à l’instar ce de qui se fait en Allemagne ou en Italie. Elles pourraient aussi bénéficier d’une plus grande proportion des recettes TVA, à l’instar ce de qui se fait en Allemagne ou Espagne. Les régions bénéficient déjà d’une partie de la TVA depuis 2018. Il est prévu qu’il en aille de même pour les départements, pour compenser le manque à gagner consécutif au transfert de la taxe foncière aux communes suite à la suppression de la taxe d’habitation. Des solutions existent. Il est grand temps d’aller de l’avant sur ce sujet, encore plus crucial aujourd’hui qu’hier.
La crise sanitaire confirme que l’État n’est pas toujours le bon niveau pour résoudre des problèmes collectifs devenus, on le voit, de plus en plus complexes. Des solutions plus performantes peuvent être trouvées à l’échelon local, où les effets de l’uniformité se font également ressentir négativement dans le domaine fiscal.
L’autonomie financière n’a été concédée que du bout des lèvres et reste suspendue, surtout dans sa dimension fiscale, au bon vouloir de l’État. Malgré la constitutionnalisation de la notion d’ « autonomie financière locale » en 2003, les collectivités territoriales ne disposent pas de protection juridique forte contre les empiètements de l’État. Leurs marges de manœuvre en matière de fiscalité sont des plus limitées : les élus locaux votent des taux dans certaines limites, mais la définition des impôts et la détermination des assiettes sont du seul ressort de l’État. En 2015, avant donc la suppression progressive de la taxe d’habitation, le taux d’autonomie fiscale (assiette territorialisée et taux fixé par les assemblées délibérantes) n’était que de 31,2 % pour l’ensemble des niveaux de collectivités locales. L’intervention massive de l’État dans la fiscalité locale a conduit en outre à distinguer de plus en plus nettement la population des contribuables locaux de celle des électeurs locaux. Ce phénomène, encore accentué par la suppression programmée de la taxe d’habitation, crée un mauvais système d’incitation dans la définition et la gestion des dépenses locales. La preuve de l’agilité des collectivités conjuguée au besoin d’efficacité pourrait conduire à resserrer le lien entre taxation et représentation, en conférant aux élus locaux davantage que de simples responsabilités de gestion enfermées dans un cadre uniformisé.
Quelles orientations pouvons-nous esquisser à partir de ce diagnostic ?
- Qu’il serait urgent de réduire le « coin fiscal » composé d’un empilement de prélèvements assis sur les revenus du travail et du capital ;
- Qu’il serait utile de réduire les taux marginaux de l’impôt sur le revenu et d’abroger de nombreuses « niches » fiscales ;
- Qu’il serait souhaitable d’améliorer la structure des taux des TVA, en se rapprochant le plus possible d’un taux unique ;
- Qu’il faudrait démanteler nos impôts « de production », en compensant le manque à gagner pour les collectivités par l’attribution d’une quote-part d’impôt sur le revenu et de TVA ;
- Qu’il pourrait être également opportun de consacrer dans la Constitution un véritable pouvoir local de décision fiscale.
Retrouvez sur le site Réformer pour Libérer toutes les analyses et propositions, préparées par Jean Arbod, Patrick de Casanove, Jean-Philippe Delsol, Christophe Demerson, Jean-Philippe Feldman, Victor Fouquet, Jacques Garello, Pierre Garello, Guillaume Labbez, Nicolas Lecaussin, Jean-Thomas Lesueur, Nicolas Marques, Emmanuel Martin, Alain Mathieu, Erwan Le Noan, Laurent Pahpy, Pascal Salin, Eric Verheaghe et Aurélien Véron.