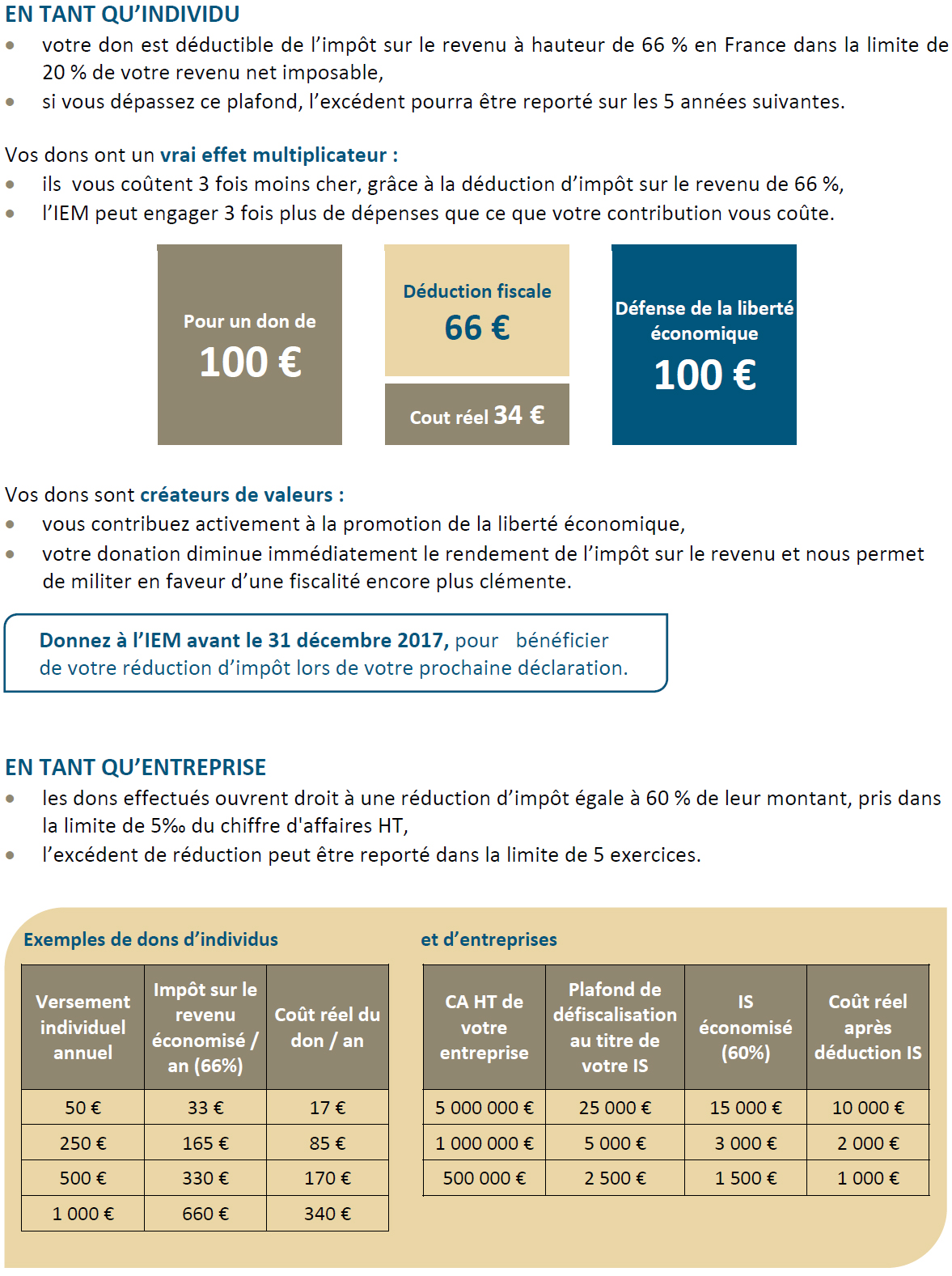L’austérité, quelle austérité ?
Article du journaliste Robert Jules publié le 14 mai 2012 dans La Tribune.
Le débat politique sur l’austérité a pris de l’ampleur avec les élections grecque et française. Pourtant, les statistiques montrent que les coupes dans les dépenses publiques restent modestes pour réduire le déficit public. Ce sont surtout les majorations des taxes qui contribuent à l’assainissement des comptes.
L’austérité s’est imposée comme thème dominant dans le débat politique international. Mais au delà du mot, quel véritable sens donner à la politique qui s’y réfère ? Le prix Nobel d’économie Paul Krugman, chroniqueur influent au New York Times, a ainsi vu dans le résultat des élections en France et en Grèce le rejet des politiques d’austérité prônée par l’Europe sous influence allemande. Surtout, il soulignait que «les revendications en faveur d’une réduction des dépenses publiques qui encouragerait d’une certaine façon les consommateurs et les entreprises à dépenser davantage ont été largement réfutées par l’expérience des deux années passées.»
Une attitude religieuse
Il y a plus d’un an déjà, Paul Krugman avait critiqué le choix de la gestion de la crise de la dette européenne qui offrait comme seule stratégie l’austérité pour assainir les finances publiques et réduire le poids des dettes souveraines. Il y voyait une attitude typiquement religieuse – ils ont péché et en conséquence ils doivent être punis – au détriment d’une approche économique pragmatique. Il pronostiquait alors qu’en menant concomitamment des politiques d’austérité les pays de la zone euro allaient réduire leur croissance économique. A regarder la situation actuelle, ses anticipations étaient justes puisque la zone euro devrait, selon les derniers chiffres de la Commission européenne, voir son PIB se contracter de 0,3% cette année.
Mais les propos de Krugman ont, outre-Atlantique, déclenché un débat. La relance par la demande publique ou la planche à billets – que l’on désigne comme politique « keynesienne » -, celle qui a été choisie par le président Barack Obama, en quête d’un second mandat, est largement critiquée. Parmi les opposants à Krugman, on trouve l’économiste française travaillant aux États-Unis, Véronique de Rugy. Elle pointe surtout où se situe la nature du débat, qui porte sur l’arbitrage entre coupes dans les dépenses et majoration des taxes pour générer des recettes. Or, elle constate que les dépenses publiques dans les pays censés mener une telle politique sont en constante augmentation : Espagne, Royaume-Uni, France et Grèce. «La France et le Royaume Uni n’ont pas fait de coupes dans leurs dépenses», souligne-t-elle (voir son graphique).
Ralentir la hausse des dépenses
D’ailleurs, François Hollande, le nouveau président français, avait lui-même, durant sa campagne, indiqué qu’il comptait non pas réduire les dépenses mais ralentir leur hausse, de + 2% à +1%, dans les prochaines années. Selon les dernières estimations de la Commission européenne, le poids de la dépense publique en France, après 55,9% du PIB en 2011, devrait représenter 56,3% en 2012 et 56,2% en 2013. Il s’agit du pourcentage le plus élevé dans la zone euro. Si l’on prend l’exemple de la Grèce, où l’austérité bat son plein, les chiffres sont de 50% en 2011, 49,7% en 2012 et 50,6% en 2013.
Aussi, s’il y a augmentation des dépenses publiques et si le déficit public en pourcentage rapporté au PIB diminue, ce sont les recettes qui doivent augmenter. Pour la France, les recettes ont représenté 50,7% du PIB en 2011, et sont prévues à 51,8% en 2012 et 52% en 2012. Et l’Italie, qui devrait voir la part de ses dépenses publiques se réduire par rapport au PIB entre 2011 et 2013, voit en revanche la part des recettes augmenter de 46,1% en 2011 à 48,4% en 2012 et 48,4% en 2013. Dans un contexte de croissance faible, c’est la hausse des taxes qui expliquent donc cette tendance.
Or Véronique de Rugy explique qu’une telle approche n’est pas de nature à résoudre le problème de la dette. Pour cela, elle se fonde sur une étude publiée en 2009 par deux chercheurs, Alberto Alesina et Silvia Ardagna, qui analysent les 107 tentatives de réduction de dette dans 21 pays de l’OCDE entre 1970 et 2007. Leur conclusion et que les réductions des dépenses sont plus efficientes que la hausse des taxes pour réduire le ratio dette/PIB.
L’économiste française cite également une autre étude de l’Institut américain de l’entreprise qui analyse 100 cas de politiques menées pour réduire les déficits. Là aussi, la conclusion des auteurs de l’étude est que parmi les pays qui ont échoué, ceux qui avaient augmenté les taxes représentaient 53 % et ceux qui avaient fait le choix de réduire les dépenses, 47%. Quand aux pays qui ont réussi, 85% avaient réalisé des coupes dans les dépenses.
Le rôle accru des stabilisateurs sociaux
Face à ces critiques, Krugman a, à juste titre, souligné la nécessité de tenir compte du fait qu’en période de récession certains postes de dépenses augmentent mécaniquement, par exemple, celui du chômage. Il ne s’agit donc pas selon lui d’une extension du rôle de l’État-providence mais seulement de la hausse de certaines prestations. De même, certaines dépenses publiques, par exemple dans le cas de l’Irlande, sont dues à des sauvetages financiers du secteur bancaire.
Même si ce transfert est important, et même si nous admettons le rôle accru des stabilisateurs sociaux, il n’en reste pas moins que l’État ne coupe pas pour autant ailleurs. Si en Grèce nombre de fonctionnaires ont vu leurs salaires baisser, et si les dépenses ont continué à augmenter, cela montre que l’État n’a pas pu trouver ou imposer le niveau de coupes nécessaire pour inverser la tendance.
La nécessité de réformes structurelles
Car ces décisions relèvent évidemment de choix politiques, qui impliquent des changements profonds, des réformes structurelles, par exemple en matière de marchés du travail. Dans une ouvrage édité par le FMI, Chipping Away at Our Debt, cité par Véronique de Rugy, les auteurs soulignent que pour réduire le déficit public et le poids de la dette, de telles réformes structurelles, qui visent à réduire le rôle et la part de l’État dans l’économie, nécessitent également qu’elles soient ambitieuses et s’inscrivent dans le moyen et long terme pour produire les effets significatifs. Last but not least, elles ont besoin de l’adhésion des citoyens.
Si l’on revient à la Grèce et aux dernières élections, le succès du parti de la gauche radicale Syriza, arrivé en deuxième position, n’est pas seulement dû à son programme contre l’austérité mais aussi au fait de conserver le statu quo du fonctionnement actuel de l’économie du pays. Autrement dit, le rejet d’un changement structurel du fonctionnement de l’administration grecque fondé, il faut le rappeler, sur le clientélisme et la corruption endémique.